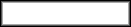
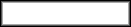
Deuxième partie:
Les droits des citoyens : des principes proclamés aux droits effectifs
La consécration constitutionnelle ou législative des droits et libertés n'en assure pas nécessairement le respect quotidien. L'histoire le montre abondamment.
Le principe du suffrage universel s'est résumé pendant longtemps au seul droit de vote des propriétaires de sexe masculin. Pour conquérir ce droit, les pauvres ont dû attendre 1848, les femmes 1945 et les jeunes de dix-huit ans 1974. La liberté de la presse n'a reçu sa pleine consécration qu'en 1981.
La lecture attentive de la Déclaration de 1789 fait apparaître un divorce entre les droits proclamés et la réalité quotidienne.
Ainsi, l'Article premier affirme-t-il : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » Et pourtant nombreux sont ceux qui vivent asservis et inégaux !
Faudra-t-il attendre de longues années avant que l'Article 9 ne reçoive pleinement son application en France ? « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s 'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »
Et que dire de l'inapplication de l'Article 13 qui exige que la contribution fiscale soit « également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ? On ne peut pas ne pas penser aussitôt à l'iniquité de la fiscalité locale ou aux privilèges consentis aux bénéficiaires de revenus du capital.
Plus cruelle encore serait la confrontation de l'état réel de la société avec le préambule de la Constitution de 1946 qui proclame tout à la fois le droit à l'emploi, le droit à l'instruction, le droit à la santé.
Instruits que nous sommes par l'expérience, nous devons dans le futur ne plus nous payer de mots, si beaux soient-ils. Nous devons nous employer à réduire la distance qui sépare les textes de leur mise en œuvre pratique. Apprenons à descendre du ciel des principes proclamés pour revenir à la terre ferme des droits effectifs.
Pour ce faire, deux conditions doivent être accomplies :
1 - UNE RECONNAISSANCE PLUS CONCRETE ET PLUS COMPLETE
DES DROITS ET DES LIBERTÉS DES CITOYENS
Cette reconnaissance plus active doit porter sur deux types de droits :
- les principes républicains qui fondent notre société - l'égalité, la liberté, la laïcité sont menacés par les progrès de l'ultra-libéralisme. Notre devoir est de leur assurer une consolidation concrète ;
- de nouveaux droits répondant à la montée d'aspirations nouvelles méritent d'être pleinement consacrés.
A - LA CONSOLIDATION CONCRÈTE DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS
1) L'égalité plutôt que « l'équité »
Le retour de la gauche au pouvoir doit refonder un pacte de citoyenneté autour d'un idéal de justice renouvelée.
a) Les droits économiques et sociaux du Préambule de 1946
L'écart entre droits proclamés et droits effectivement réalisés est ici tristement éclatant : au premier chef, le droit d'obtenir un emploi, le droit au logement et le droit aux soins.
Ces droits ne se traduiront par des prestations réelles au bénéfice de tous que si, par des politiques publiques ambitieuses, nouvelles, des changements profonds sont apportés à notre société.
C'est ainsi qu'il nous faudra rouvrir l'immense chantier de l'Education nationale, abandonné depuis trois ans. Nous devons faire preuve d'imagination et d'invention pour faire progresser d'un même pas l'épanouissement individuel et collectif des jeunes, la démocratisation du système éducatif et la lutte contre les échecs scolaires. Cela signifie fondamentalement l'égalisation des chances, à l'école et par l'école : au cœur des systèmes éducatifs, l'élève doit vivre l'égalité depuis la première enfance jusqu'à l'université grâce à un effort de redistribution nationale qui compense les différences matérielles - et autant que possible culturelles - devant l'accès au savoir.
La politique du logement aura une ambition simple : permettre à chacun d'avoir un toit. Cette volonté implique à l'évidence un effort financier important, mais comment exercer sa citoyenneté si l'on n'a pas d'adresse ?
Le droit au travail n'est pas assuré aujourd'hui. C'est l'une des causes centrales des ruptures de la cohésion sociale, du repli sur soi et de la montée des extrémismes. C'est la principale menace pour la démocratie. Le droit au travail est un fondement de la citoyenneté. Pour nous, cela a deux conséquences : d'une part offrir à tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi un accompagnement individuel, si nécessaire un parcours d'insertion, qui leur donne de meilleures chances de retrouver un emploi ; d'autre part mettre comme perspective politique centrale de l'action des socialistes, l'emploi pour tous.
En définitive, l'enjeu pour les socialistes est de donner à chacun le droit de vivre, de vivre dans une vraie ville où il existe une mixité sociale, où l'on trouve non seulement des logements mais aussi des lieux de travail, de loisirs, de culture et des services publics. Reconstruire de vraies villes prendra du temps et nécessitera des moyens financiers importants.
Naturellement, la garantie de ces droits va de pair avec la mise en responsabilité des citoyens. Accéder à des droits ne signifie pas assistance, mais, au contraire, opportunité de se prendre en charge et de s'en sortir, et aussi de devoir se prendre en main, dans la mesure où l'accès aux droits concrets est effectivement assuré.
Tous ces points seront naturellement au cœur de la prochaine convention que les socialistes tiendront à l'automne.
b) La protection sociale
Citoyenneté et protection sociale ont partie liée. Particulièrement en France où la construction républicaine est historiquement bâtie sur la garantie d'un certain nombre de droits sociaux qui permet de réunir ensemble les citoyens français dans une comunauté de destin. C'est parce que le citoyen a un accès garanti et égal à un certain nombre de droits sociaux (travail, logement, protection sociale, accès au système de sécurité sociale, retraite, services publics) que la République est vraiment la chose de tous.
Ce système de droits est aujourd'hui, dans la protection sociale, doublement sapé par la montée du chômage de masse, qui provoque la crise financière des régimes sociaux et par l'augmentation des inégalités.
Les socialistes pensent que le principe d'égalité demeure le meilleur ciment civique. La protection sociale en particulier a besoin, pour traduire ce principe, de règles de fond et pas seulement de procédures. Ces règles peuvent, certes, être adaptées à la complexité sociale, aux différences de situation, respectueuses de l'exigence moderne d'autonomie, mais elles doivent être universelles et objectives.
En pratique, ce n'est pas moins, mais plus de mutualisme, un mutualisme plus global, qu'il faudra donc rechercher pour l'avenir de la protection sociale.
A l'horizon, cela signifie explorer des pistes comme la création d'une couverture universelle de sécurité sociale, contrepartie à la précarisation du travail et ne séparant plus les « exclus » relevant de l'aide sociale, des bénéficiaires de régimes d'assurés sociaux ; l'organisation d'un droit à la reconversion permanente remplaçant le système d'assurance chômage (qui n'était censé indemniser que le chômage conjoncturel) et garantissant la stabilité professionnelle.
La politique de la santé doit privilégier l'égalité dans la qualité et l'accès aux soins et assurer une couverture universelle et un meilleur remboursement : notre pays connaît actuellement environ 600 000 exclus de toute couverture maladie. Une personne sur cinq renonce à certains soins pour des raisons financières (dentisterie, lunetterie, analyse de laboratoire), la recrudescence de la tuberculose inquiète, l'espérance de vie est différente de plus de neuf ans entre un ouvrier et un cadre, la France est très en retard en matière de prévention, le niveau de remboursement des soins nous place au seizième rang des pays développés. Le respect de l'égalité des soins demande une attention particulière pour la prise en charge des personnes contaminées par le virus du SIDA. Cela vaut aussi pour les toxicomanes, les détenus.
La législation actuelle du tout répressif en matière de drogue relègue les toxicomanes dans une situation de quasi-clandestinité, les met à l'écart du système de soins et empêche la mise en place d'une politique de réduction des risques efficace. Rappelons qu'avec la loi de 1970, la France est, parmi les pays européens, l'une des nations les plus répressives en matière d'usage de stupéfiants, notamment du cannabis. Une révision de cette loi, qui assimile simple consommation, abus et trafic de drogues, s'impose pour considérer les toxicomanes, consommateurs de drogues dures, comme des malades ayant besoin de soins et non comme des délinquants. Il est indispensable de lever les contradictions majeures entre santé publique et répression, de repenser la prévention, la réinsertion, et de poser le débat sur la dépénalisation de l'usage simple de cannabis (cf. rapport Henrion).
Dans le cadre de la maîtrise des dépenses de santé, le Parlement doit pouvoir se prononcer non seulement sur les dépenses remboursables par la sécurité sociale, mais également sur la part non-remboursable, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses reconnues de santé publique.
Ne pas le prévoir, c'est prendre le risque que le déremboursement équilibre les comptes sociaux, c'est encore prendre le risque du développement d'une médecine à deux vitesses.
c) Les services publics plutôt que les services « universels »
Le principe d'égalité est aussi à la base des services publics.
Les trains accessibles à tous, l'électricité et le gaz à tous les étages, l'école publique obligatoire et gratuite, la poste et le téléphone pour tous, ont diffusé l'évidence de l'égalité entre les citoyens. Cette culture politique de masse, d'essence égalitaire, est significative de notre époque, qui engendre une dynamique de mobilisation lorsqu'il arrive que l'inégalité des moyens soit un obstacle à l'exercice d'un droit reconnu égal pour tous. Chacun sait que pour maintenir un bureau de poste ou une classe dans une école, il ne manque jamais une signature sur les pétitions.
C'est bien ce mouvement contagieux de l'égalité que combat le libéralisme, en y opposant aujourd'hui la notion d'équité, avec le droit européen de la concurrence comme arme.
« Service universel » : dans le prolongement de son entreprise de libéralisation des services d'intérêt économique général, la Commission Européenne est tentée d'offrir, comme unique concession, cette notion minimale, qui correspond à la vieille idée libérale du filet minimum de sécurité. Elle recouvre le droit, pour tout citoyen de l'Union, d'accéder aux services dits « d'intérêt général » à un « prix abordable ». Il s'agit de garantir aux foyers les plus modestes l'accès à des services comme le téléphone, la poste, l'électricité ou le train, après la disparition des monopoles de service public qui assurent aujourd'hui ces prestations. Cela signifie qu'il est implicitement admis que, dans le contexte d'ouverture à la concurrence d'opérateurs privés que préparent les directives en chantier, la recherche de la rentabilité conduira à de fortes hausses de certains tarifs.
Dans le domaine des télécommunications, la nouvelle réglementation proposée par le gouvernement Juppé préfigure cette notion de service universel. Avec l'ouverture à la concurrence que le droit européen imposera en 1998, la péréquation à large échelle entre les services bas de gamme (communications locales, le téléphone de tous, subventionné de fait) et les services hauts de gamme (le téléphone international, les services à valeur ajoutée aux entreprises...) sera abandonnée : dès maintenant les grands opérateurs de demain, publics et privés, français et européens, augmentent les tarifs des premiers. Pour compenser l'effet antisocial sur les foyers les plus modestes, des tarifs socialement ciblés seront imposés, mais pour le seul service téléphonique de base auquel se réduit le « service universel » : c'est ce que France Télécom propose déjà avec sa formule d'abonnement spécial « foyers modestes » pour un service minimum incitant à recevoir plus qu'à donner des communications. Ce service minimum, universel, va donc remplacer le service public fondé sur des principes d'égalité et de solidarité.
Cette évolution du service public vers l'assistance, de l'égalité vers l'équité, commencée dans le champ de l'énergie, des télécommunications, des postes et des transports, a vocation à s'étendre demain aux autres champs du service public : la santé, voire l'éducation.
Mais les mentalités dans l'Union Européenne sont en train d'évoluer : elles prennent conscience du rôle éminent des services publics comme élément de la cohésion sociale et de la citoyenneté européenne, et partant, de son apport fondamental au modèle social européen. La défense de celui-ci doit former le ciment de la gauche européenne. Or, la Conférence intergouvernementale offre aujourd'hui l'occasion de modifier les traités européens, sachant que le débat entre service public et concurrence n'est pas tranché, y compris au sein de la Commission Européenne : il faut donc agir de concert avec toutes les composantes du mouvement social en France et en Europe, qui sont en train de se mobiliser, dans le sens d'un rééquilibrage entre services publics et règles de la concurrence allant au-delà du « service universel ». Cela est possible en prévoyant d'inclure dans les principes de l´Union européenne le rôle particulier dévolu aux services publics en modifiant l'article 90 du Traité, en rédigeant une charte des services publics européens, qui figurerait en annexe du Traité, et en créant un observatoire au sein du Parlement Européen veillant au respect de l'équilibre entre service public et concurrence.
2) La liberté contre l'arbitraire
a) Les libertés individuelles, base de la démocratie
La protection des libertés individuelles constitue un des fondements de l'Etat de droit et doit bénéficier à toute personne présente sur le territoire de la République, Français ou étranger.
Cela concerne notamment :
§1 - La liberté de conscience, de pensée et d'opinion, qui se combine avec le principe de la laïcité
(voir infra p. 40)
§2 - La liberté d'expression et de communication (voir supra p. 26)
§3 - Le droit de vivre en sécurité qui doit être partout garanti à chaque citoyen
A côté de la sûreté, doit prendre place une préoccupation incontournable de sécurité quotidienne.
C'est pourquoi les socialistes doivent prendre en compte cette exigence en définissant une politique de la sécurité publique qui concilie un dispositif de prévention-dissuasion-répression de la délinquance et le respect des droits individuels.
Dans ce domaine, l'action des forces de police et de gendarmerie joue un rôle essentiel et il conviendra qu'elles soient présentes, et particulièrement dans les régions les plus sensibles, proches des citoyens, respectées et respectueuses de chacun.
A cet effet, il faudra :
Par ailleurs, il est nécessaire d'éviter les vérifications d'identité abusives et les gardes à vue injustifiées. De même, la mise en détention provisoire devra être entourée de garanties : elle ne pourra être décidée que par le juge, qu'après un débat public et contradictoire (cf. infra p. 46), et ne devra plus pouvoir s'appuyer sur le critère de risque de trouble à l'ordre public, qui permet tous les abus. Le régime carcéral des prévenus, qui sont présumés innocents, devra être matériellement distinct de celui des condamnés.
§4 - Le respect de la vie privée
Le droit au respect de sa vie privée est menacé par les évolutions des technologies, qui envahissent la vie quotidienne de chacun. Pour ne prendre que quelques exemples : la généralisation des cartes à mémoire, liée à la constitution de réseaux d'information sophistiqués, permet de suivre à la trace les déplacements, les rencontres, les dépenses de chacun ; les progrès des communications mettent à la portée de tous les moyens techniques d'écouter les conversations les plus intimes de chacun ; la vidéo-surveillance peut contrôler et enregistrer les allées et venues des passants, parfois à leur insu.
L´Etat doit veiller à une adaptation constante des lois aux menaces qui découlent des nouvelles conditions créées par ces progrès techniques.
- La vidéo-surveillance
Au nom de la sécurité, les lois Pasqua ont permis la généralisation de la vidéo-surveillance, en s'abstenant délibérément de l'accompagner des précautions indispensables pour éviter ses conséquences sur les libertés des citoyens. Si elle permet de réguler le trafic des voitures ou de surveiller l'accès à des lieux à risques (gares, stades, banques, grandes surfaces), elle permet tout aussi bien d'observer les allées et venues ou les faits et gestes de chacun, et, dans ce cas, menace la vie privée des citoyens.
Pour éviter ces dérives dangereuses, les mesures suivantes sont nécessaires :
- Les écoutes téléphoniques
La loi de 1991 sur les interceptions de sécurité, qui instaure le premier système de contrôle des écoutes administratives a paradoxalement provoqué une croissance du nombre des écoutes judiciaires.
Les magistrats, forts d'une sécurité légale, l'utilisent comme une méthode banale d'investigation. La loi devra limiter les écoutes aux seuls cas considérés comme graves par les peines encourues, et la chambre d'accusation devra être seule qualifiée pour les autoriser.
Par ailleurs, il est nécessaire d'améliorer la composition et d'étendre les compétences de la Commission Nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui contrôle les écoutes administratives voulues par le Gouvernement.
Enfin, pour mettre un coup d'arrêt à la multiplication des écoutes sauvages, il faut aggraver les sanctions, insuffisantes, encourues par les officines de mises sur écoute, ainsi que par les particuliers qui ont recours à leurs services.
- Les fouilles de véhicules
Les lois Pasqua, qui ont généralisé les contrôles d'identité, parfois accompagnés, selon le faciès, d'arrestations arbitraires pour « vérification », n'ont pas réussi à généraliser les fouilles des véhicules, dont la limitation a été imposée par le Conseil Constitutionnel. Mais celles-ci sont pratiquées dans certains quartiers. L'une des priorités du Parti Socialiste sera de faire cesser cet état de fait, et d'abord en revenant sur les dispositions liberticides des lois Pasqua.
Car tout se passe comme s'il existait une hiérarchie entre la vie privée chez soi et la vie privée dehors, la première devant être protégée, la seconde pouvant à la rigueur être grignotée. Cette conception est contraire à la Déclaration de 1789, à notre Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas la conception des socialistes et tout devra être fait pour que la vie privée des citoyens soit intégralement protégée.
- Le maintien de l'indépendance de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L.) et le renforcement de ses pouvoirs
La récente directive européenne visant à harmoniser les lois des Etats membres de l'Union ne devrait pas donner l'occasion d'abaisser le niveau de protection des personnes offert jusqu'à ce jour en France.
Il faut exiger que les pouvoirs de la C.N.I.L. soient maintenus, voire renforcés pour, qu'à côté de son action de conseil et de recommandation, elle puisse disposer de pouvoirs effectifs de contrôle.
b) Le droit du travail menacé
Fruit de longues luttes sociales, le droit du travail est aujourd'hui menacé et, avec lui, bon nombre de protections qu'il garantissait aux salariés. La mondialisation produit ses effets sur l'évolution de la structure des entreprises comme de la forme des emplois. Pan après pan, le droit du travail se lézarde et la précarité impose trop souvent sa loi. La négociation s'étiole. Le licenciement reste la première variable d'ajustement. Les syndicats sont affaiblis. Le droit devient complexe, opaque, insaisissable.
L'offensive du capitalisme dérégulateur concentre ses efforts vers toujours plus de flexibilité et d'abaissement du coût du travail. C'est la politique du gouvernement Juppé qui, en guise de lutte contre le chômage, multiplie les allégements de cotisations sociales et accentue la précarité qui porte en elle pour demain la transformation de salariés en pseudo entrepreneur individuel et le développement du travail au noir. C'est pourquoi nous abrogerons la loi Madelin; Déjà, plus du tiers des salariés sont, soit au chômage, soit en statut précaire. De plus en plus de jeunes - et de moins jeunes- ne connaissent qu'une succession de contrats à durée déterminée sans parvenir à un emploi stable.
Choisir la liberté contre l'arbitraire, c'est permettre aux salariés de se réapproprier le droit du travail et, surtout, rééquilibrer le rapport de forces dans l'entreprise (voir infra p. 83).
c) Le droit des étrangers
En France, il existe historiquement une tradition républicaine de lien entre la citoyenneté et la nationalité. C'est le principe du droit du sol pour l'accès à la nationalité. Elle se traduit aussi par l'ouverture plus large que dans beaucoup d'autres pays, du droit à la naturalisation. Ces principes ont été remis en cause par la loi Méhaignerie.
En outre, la politique de la droite au pouvoir depuis 1993 a eu pour objectif de fragiliser et de montrer du doigt les étrangers. Les lois Pasqua, les propositions de la commission Philibert ne se contentent pas seulement de limiter les droits des étrangers. Elles véhiculent l'idée que tout étranger est potentiellement coupable. Elles créent pour eux de l'insécurité juridique, particulièrement pour les enfants d'immigrés établis régulièrement en France, pour les parents étrangers d'enfants français, pour les conjoints de Français. Elles engendrent la peur, la division et des situations humaines inextricables. Elles sont inefficaces au regard de leur propre logique dans la mesure où elles n'ont pas enrayé l'immigration irrégulière et où elles fabriquent même de nouveaux clandestins.
Ainsi, les lois Pasqua bafouent les droits individuels les plus élémentaires sans réussir à maîtriser les flux migratoires.
Une politique nouvelle doit reposer sur quatre principes:
Les axes majeurs d'une politique de l'immigration doivent être définis, qui ne peuvent cependant tenir lieu de politique de la ville ou de politique de l'emploi :
L'intégration de tous les étrangers résidents permanents dans notre pays demeure un objectif central. Cette intégration est fondée sur l'égalité des droits, la laïcité, le refus de toute discrimination et du racisme. Cela implique en particulier, l'apprentissage par tous de notre langue, qu'il faut favoriser concrètement. Cela demande aussi des moyens concrets d'accueil et d'accompagnement.
L'école laïque, moderne, forte des moyens que lui assurera la nation, doit être l'un des premiers acteurs de ce combat.
Ce souci d'intégration justifie enfin que les étrangers, établis depuis longtemps sur notre territoire, puissent voter aux élections municipales. N'est-ce pas l'un des leviers de l'intégration que de participer aux décisions qui concernent directement la vie quotidienne, d'être partie prenante, avec tous les autres habitants, du choix d'équipements et de services publics locaux ?
La mise en œuvre de ce droit se heurte aujourd'hui à des obstacles constitutionnels qui rendent impossibles sa mise en œuvre immédiate. Mais il doit rester fermement notre projet.
3) La laïcité, pilier de la République
Face au regain des intégrismes religieux de tous bords, aux tentations des replis communautaires, aux attaques gouvernementales contre la laïcité, les socialistes doivent réaffirmer leur attachement au principe de la laïcité, qui constitue l'un des fondements de la République.
Etablissant une séparation radicale entre la société civile et politique et la société religieuse, ce principe fonde à la fois une éthique moderne et un système institutionnel.
a) Une éthique moderne
Faite de connaissance, de reconnaissance et de respect d'autrui, la laïcité doit conduire à faire la part de ce qui est de l'ordre du respect des convictions, des comportements et des cultures individuelles, et de ce qui relève des valeurs républicaines s'imposant à tous.
La laïcité repose sur un socle de trois valeurs républicaines essentielles qui sont la liberté de conscience et d'expression, la tolérance réciproque et la solidarité.
§1 - En tant que liberté, la laïcité consiste à accepter toutes les croyances et à permettre toutes les pratiques religieuses pour autant qu'elles ne mettent pas en cause les principes républicains. Mais en un temps, en un contexte politique où la poussée générale des intégrismes de par le monde donne toute son actualité à l'exigence laïque, il faut rappeler que la République, en France, a donné à la laïcité un support institutionnel : c'est le régime de séparation des Eglises et de l'Etat. Or c'est précisément ce fondement institutionnel qui est aujourd'hui mis en question, notamment par des personnalités religieuses de premier plan. Le PS ne pourrait accepter un tel abandon. L'Etat veillera à ce que ses représentants, dans l'exercice de leurs fonctions, respectent le principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
§2 - La laïcité doit s'appuyer sur la tolérance réciproque et le respect mutuel et combattre toutes les formes d'intolérance et d'intégrisme. Elle exige que chacun connaisse et partage les valeurs de la République, bases de la vie en société, et notamment le droit à l'égalité. Le droit à la différence religieuse ne saurait en effet légitimer une inégalité de traitement entre les individus et des différences de droits.
§3 - Troisième élément constitutif de la laïcité, le principe de solidarité est fondé sur l'exigence de justice sociale et d'égalité des chances. C'est pourquoi la laïcité suppose tout un dispositif politique, économique et social d'intégration.
§4 - II convient de ne pas confondre laïcité, liberté de pensée et leurs dévoiements. Le développement du phénomène des sectes ne saurait être posé en terme de liberté de pensée ou de religions car leur objet est précisément de priver les adeptes de leur libre arbitre. En utilisant la manipulation mentale, des gourous soi-disant initiés soumettent à leur entière dévotion ceux qui sont en quête de recherche spirituelle ou qui tout simplement veulent oublier un quotidien médiocre. Pareille exploitation constitue une grave atteinte à notre dignité, à l'ordre public et à la démocratie. Elle doit être sanctionnée.
b) Un système institutionnel
Un système politique laïc doit d'abord assurer une stricte séparation entre l'Etat et les églises.
Il doit, en particulier dans le cadre de l'enseignement, faire tout à la fois connaître à chacun et partager les valeurs de la République et les droits et libertés des citoyens qui fondent l'appartenance à la collectivité nationale, et découvrir la diversité historique et culturelle de notre pays sur laquelle repose aujourd'hui la coexistence de pratiques culturelles, communautaires et religieuses différentes. L'école de la République, lieu privilégié d'intégration et d'égalisation des chances, a la responsabilité première d'expliquer les valeurs de la République et de faire vivre les enjeux de la laïcité.
Mais la laïcité ne doit pas se vivre qu'à l'école : elle est la charte de notre société démocratique. A ce titre, elle n'est pas seulement une attitude passive de respect de la liberté de l'autre. Elle est aussi un combat permanent pour l'égalité de tous dans la perspective d'une véritable citoyenneté.
C'est pourquoi la laïcité est indissociable de l'intégration de tous à la communauté nationale, quelles que soient les origines religieuses, culturelles ou sociales. Nous voulons un citoyen libre et maître de ses choix privés, y compris face à sa communauté d'origine.
La voie privilégiée de l'intégration ne saurait donc être la voie communautaire.
B - LA CONSÉCRATION DE DROITS NOUVEAUX
D'abord, une exigence de portée générale : élargir la définition des droits de l'homme en France à l'ensemble des droits reconnus au plan européen. La Constitution sera modifiée pour intégrer la Convention européenne des droits de l'homme dans le texte comme élément de définition des droits en France. Ceci permettra d'accroître le bloc de constitutionnalité en matière de droits de l'homme, alors même que la France est aujourd'hui souvent condamnée devant la Cour européenne des droits de l'homme pour non-respect de cette Convention.
Sans préjudice, d'autres droits nouveaux à consacrer : le droit à la dignité, l'environnement, la parité femmes-hommes, le Contrat d'union sociale doivent être immédiatement pris en considération.
1) Le droit à la dignité
II peut paraître surprenant d'ériger au rang de droits nouveaux le principe du respect de la dignité humaine tant cette notion paraît être depuis longtemps enracinée dans nos esprits.
L'étrangeté est que ce concept n'a pas été en tant que tel proclamé dans la Déclaration des Droits de l'Homme et dans les préambules des Constitutions de 1946 et 1958.
Il figure simplement dans l'exposé des motifs du préambule de la Constitution de 1946 où l'on évoque la victoire des peuples libres sur les régimes qui ont dégradé la personne humaine.
Il faudra attendre la décision du Conseil Constitutionnel du 27/07/1994 (relative à la loi sur la bioéthique) pour que ce principe soit constitutionnalisé. C´est pourtant un principe plus fondamental encore que tous les autres. Il est consubstantiel à la personne humaine. Il est le premier des droits de l'homme. Il est à la jonction des droits civils et politiques et des droits sociaux. Il est interprété dans plusieurs systèmes de droit comme interdisant tout à la fois les traitements inhumains et dégradants, et les atteintes à la personne consécutives à la pauvreté.
Ce principe, qui est au cœur de l'humanisme de ce temps, devra être, le jour venu, inclus dans nos textes constitutionnels.
Par ailleurs, les socialistes s'engagent à mettre en œuvre les principes contenus dans la Convention internationale des droits de l'enfant.
2) Environnement : l'urgence écologique
Avec les alertes répétées à la pollution de l'air en ville, avec la crise provoquée par l'utilisation de l'amiante avec les phénomènes de pollution de l'eau avec les problèmes d'élimination des déchets, la prise de conscience de la crise écologique a franchi un seuil en France. L'écologie urbaine est devenue une préoccupation qui renforce le sentiment d'interdépendance des individus face aux conséquences du fonctionnement de l'économie (accroissement de l'effet de serre, couche d'ozone, pluies acides, destruction des forêts, disparition des espèces, danger nucléaire).
Le lien est logiquement fait entre les dégradations irrémédiables de l'environnement et le modèle de développement focalisé sur le profit maximum ou le rendement à tout prix et à court terme. Une conscience sociale élargie en résulte. Elle augmente la demande de règles et d'obligations applicables à tous. En ce sens, elle nourrit l'exigence de citoyenneté. Elle en étend aussi le champ d'action. Qui peut imaginer que la lutte contre l'effet de serre puisse s'effectuer sans des décisions mondiales ? Qui peut imaginer que le rééquilibrage du transport de marchandises en faveur du rail se fera sans volonté politique claire, se traduisant par des décisions nationales, voire européennes ? Qui peut imaginer que la pollution de l'air dans les grandes villes reculera sans implication publique locale ?
Bref, chacun comprend mieux que tous les grands sujets écologiques concernant l'eau, l'air, les forêts, l'environnement urbain, la biodiversité exigent désormais une volonté collective forte et des outils d'action publique qui portent, du niveau planétaire au niveau le plus local, l'intérêt général. Bref, il s'agit bien d'appropriation collective et de responsabilité partagée sur ce qui est vécu comme un patrimoine commun de l'humanité sur lequel les générations futures ont un droit inaliénable.
François Mitterrand, au nom de la France, a, au sommet de Rio, défendu cette belle idée de « patrimoine commun de l'humanité » en demandant que des règles d'intérêt général fixent le cadre d'utilisation des ressources naturelles. Déjà une première avancée a eu lieu avec la reconnaissance de l'Antarctique comme « patrimoine de l'humanité » contre la voracité des prospecteurs miniers.
Mais pour l'essentiel, l'exploitation sans prise en compte des valeurs de remplacement et le laisser faire libéral l'emportent. Car, si avec la crise écologique, la nécessité du collectif s'impose, le capitalisme y répondra avec ses armes et ses méthodes : le tout marchand. Il est dommage que la France, depuis trois ans, néglige les « acquis de Rio », dossier fondamental pour la paix mondiale.
Par ailleurs, l'état catastrophique de l'environnement dans les pays d'Europe Centrale et Orientale démontre que, sans démocratie, l'environnement est cruellement anéanti et, qu'à l'inverse, la démocratie aurait sans doute empêché Tchernobyl.
C'est pourquoi l'urgence écologique impose la reconnaissance d'un droit constitutionnel du citoyen à la préservation de son environnement et une intervention renforcée de la puissance publique.
3) La parité femmes-hommes
Réaliser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, garantir la dignité des femmes par le droit à la maîtrise de leur corps et la lutte contre la violence sexiste, assurer leur pleine participation à la vie publique et sociale : ce sont trois finalités de notre action pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes.
La réussite de ce combat passe principalement par une politique gouvernementale nouvelle. Elle se heurte cependant à des obstacles juridiques lorsqu'il est envisagé, par exemple, de garantir par la loi une égale représentation des femmes.
Pour vaincre cette difficulté, nous souhaitons qu'un principe de valeur constitutionnelle consacrant la parité femmes-hommes soit inscrit dans notre constitution.
4) La reconnaissance de nouveaux droits liés à l'évolution de la société
15 à 20 % de Français vivent en couple hors du mariage par choix ou par impossibilité. Hétérosexuels ou homosexuels, ils disposent de droits limités et précaires ou sont dans une situation de quasi non droit.
Il s'agit aujourd'hui de prendre en compte des modes de vie nouveaux en ouvrant l'accès à un statut ouvert à tous : le Contrat d'Union Sociale, forme d'union universelle donnant un cadre juridique à tous ceux qui souhaitent unir leurs destins autour d'un projet commun de vie.
Le fondement du Contrat d'Union Sociale est la solidarité des cocontractants, et le soutien matériel et moral auquel ils s'obligent.
5) Le droit à la requalification permanente
Le droit d'apprendre à toutes les étapes de la vie est un des droits sociaux fondamentaux. C'est pourquoi, vingt-cinq ans après que la loi ait reconnu aux salariés le droit à la formation professionnelle continue, il faut dépasser le cadre du seul code du travail pour reconnaître à toutes et à tous le droit à une éducation permanente, incluant le droit à l'orientation et à la validation des acquis.
Une négociation tripartite Etat (Education nationale-Formation professionnelle)-Patronat-Syndicat devra élaborer pour donner sa pleine extension à la loi de juillet 1992, un dispositif de mise en valeur de la validation des acquis professionnels permettant à un salarié qui occupe une fonction et des responsabilités d'obtenir - au besoin après congé formation - la validation diplôme de son métier. Véritable deuxième chance de qualification, ce dispositif permettra de renforcer la stabilité professionnelle et sociale de salariés qui devront, dans les années qui viennent, changer plusieurs fois de métier durant leur parcours.
II - UNE GARANTIE PLUS EFFECTIVE DES DROITS ET DES LIBERTES
A - LA GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS DANS LA CITÉ
1) Le rôle du législateur
a) Une radiographie complète de la législation
sur les droits et libertés sera établie par le Parlement six mois après son élection. Ce document recensera les lacunes et proposera des améliorations. Il débouchera sur l'adoption d'une « Charte des droits et libertés ».
b) Le Parlement s'imposera une exigence de clarté et de lisibilité
8 000 lois et quelque 80 000 décrets actuellement en vigueur, auxquels s'ajoutent 10 000 circulaires chaque année, ne permettent plus de prendre au sérieux l'adage : « Nul n 'est censé ignorer la loi.»
Cette prolifération anarchique n'est guère favorable à la protection de l'Etat de droit. Le droit ne se respecte que s'il est accessible et lisible.
Dans cet esprit, la codification de l'ensemble des textes devra être établie avant 2002.
2) Le rôle de l'administration
Pour rendre plus effectifs les droits du citoyen-usager face à l'administration, son fonctionnement doit être réformé dans le sens de la qualité, de l'impartialité, de la clarté et de la responsabilité.
Evoquons quelques-unes des mesures qui pourraient répondre à cette préoccupation.
a) La qualité du service
Deux réformes s'imposent :
b) La transparence du fonctionnement du service public
Elle pourrait être améliorée par quelques propositions simples :
c) Des règles plus claires pour fonder la responsabilité
Elles devraient comporter en particulier l'engagement de :
d) Une gestion publique effectivement contrôlée
La responsabilité de l'administration doit être effective. Outre la responsabilité que les citoyens peuvent mettre en jeu devant la justice, il y a les comptes qui doivent être plus systématiquement demandés de toute gestion publique : les contrôles doivent être renforcés au sein de l'administration d'Etat (y compris les administrations centrales), accompagnés d'une plus grande publicité (des programmes des corps de contrôle, souvent de leurs rapports), et sanctionnés le cas échéant (y compris par la mise en jeu de la responsabilité des fonctionnaires-ordonnateurs). Le médiateur devrait pouvoir provoquer le contrôle d'une administration.
La sanction des fautes des autorités publiques, élues ou non, peut être recherchée, mais il faut veiller à ce que cette recherche soit faite sur des bases claires, c'est-à-dire en tenant compte, en cas de délit commis par négligence ou imprudence, des responsabilités - pouvoirs et moyens - effectives de chacun. Les réparations dues aux citoyens victimes des fautes des collectivités publiques devraient être améliorées.
Enfin, n'oublions pas que la responsabilité de l'administration s'exerce avant tout devant les instances politiques : le gouvernement demeure comptable, devant le Parlement, de toute action administrative ou gestion publique. C'est pourquoi il est nécessaire de cantonner les régimes d'irresponsabilité qui se sont développés avec les autorités administratives indépendantes. Le recours à ces dernières ne s'impose pas du seul fait qu'émergent, au sein de l'Etat, des fonctions nouvelles de régulation, qui doivent être distinguées des tâches de gestion ou le cas échéant des activités d'opérateur public, mais doivent continuer d'engager la responsabilité du gouvernement. Seules les tâches de caractère juridictionnel ou quasi-juridictionnel, ou consultatif, justifient la création d'autorités administratives indépendantes.
3) Le rôle du juge
Par comparaison avec les autres démocraties d'Europe, le système juridictionnel français est encore trop imprégné par les institutions de l'Ancien Régime ou des régimes autoritaires qui ont ponctué notre histoire.
Le temps est venu de lui donner un statut adulte qui, tout à la fois, lui assure l'autonomie et garantisse les droits des justiciables.
Les réformes à accomplir devront s'attacher à rénover :
a) Un système juridictionnel, indépendant, responsable et proche du citoyen
Les relations Justice-politique-citoyens se sont détériorées. La confiance des uns dans les autres s'est dégradée au point de se transformer désormais en méfiance, voire parfois en défiance :
Cette situation n'est pas saine et ne peut permettre au justiciable de retrouver la confiance tout à la fois dans la politique et en une justice-service-public.
Dans une société démocratique moderne, la justice doit cesser d'être suspectée d'être l'instrument de règlements de comptes politiques entre le parti au pouvoir et l'opposition du moment, faisant du citoyen-justiciable le spectateur d'un dévotement indigne de cette institution, qui l'amène fatalement à douter, y compris à tort, du bien-fondé des décisions judiciaires.
Cette situation est d'autant plus regrettable que la justice en France est rendue par des magistrats compétents, soucieux, malgré leurs conditions de travail, de préserver la qualité de leur mission.
§1 - Une justice indépendante et responsable
Pour restituer la justice aux citoyens, il faut la soustraire aux injonctions ou aux pressions du pouvoir politique et tourner le dos à deux siècles de soumission organique et fonctionnelle des juges aux autorités de l'Etat.
Mais, cette indépendance ne saurait être dissociée de l'obligation non moins importante d'impartialité.
L'indépendance
Pour assurer l'indépendance, le lien qui existe aujourd'hui entre le Garde des Sceaux et le Parquet doit être coupé.
La Chancellerie doit bien sûr conserver les compétences nécessaires pour fixer les orientations de la politique pénale du pays et en surveiller l'application. Mais il faut définitivement retirer à l'exécutif la possibilité d'intervenir dans les affaires individuelles, en particulier pour s'opposer à l'engagement des poursuites pénales. Ces décisions ne doivent relever que de la responsabilité du Parquet.
Pour garantir cette indépendance nouvelle, le statut des magistrats du Parquet sera identique à celui des magistrats du Siège. Leur carrière relèvera d'un Conseil supérieur de la justice (qui se substituera à l'actuel Conseil supérieur de la magistrature).
La responsabilité
Le principe d'indépendance doit avoir impérativement pour corollaire l'exigence d'impartialité - qualité suprême d'un bon juge - par l'établissement d'une responsabilité professionnelle qui pourra être mise en cause à la requête de la Chancellerie, d'un justiciable ou d'un chef de juridiction devant le Conseil Supérieur de la Justice. Gardiens du droit, les juges doivent en être en même temps les serviteurs. Ni justiciers, ni militants, ils sont des citoyens chargés d'une mission de service public dont ils peuvent être appelés, en cas de faute, à rendre compte devant une autorité indépendante.
Le Conseil Supérieur de la Justice sera composé à parité de magistrats élus à la proportionnelle par leurs pairs et de personnalités qualifiées élues par le Parlement à une majorité renforcée des 475e. Il restera présidé par le Chef de l'Etat en formation ordinaire, et par le premier Président de la Cour de Cassation en formation disciplinaire.
Il pourra être saisi par le ministère de la Justice, par les élus et, dans certaines conditions, par les justiciables.
Ses attributions porteront notamment sur trois points :
§2 - Une justice respectueuse des libertés individuelles
Quelle que soit la noblesse de la conscience personnelle, nul n'est à l'abri d'un abus de pouvoir ou d'une appréciation partiale ou subjective. Aussi est-il indispensable que le fonctionnement du système juridictionnel facilite, par un jeu de contre-pouvoir, ce que la Convention Européenne des Droits de l'Homme appelle dans son Article 6 « un procès public équitable ».
Les réformes à accomplir sont nombreuses. Trois mériteraient d'être rapidement entreprises pour que notre système soit conforme aux traditions françaises des Droits de l'Homme :
- La transformation des procédures juridictionnelles
L'exigence du respect des droits de la défense vaut pour toute juridiction (pénale, administrative, civile, commerciale). Elle fait surtout défaut dans la procédure pénale.
Les défaillances sont connues : la violation fréquente de la présomption d'innocence, la mise en détention abusive, l'insuffisance du débat contradictoire. Le phénomène est aggravé par la médiatisation qui peut aboutir à la mise au pilori sans jugement.
Un changement de structure s'impose qui pourrait être fondé sur les conclusions de la Commission Delmas-Marty. Elle consisterait à séparer plus clairement la fonction déjuge d'instruction de la fonction du Parquet.
Le juge d'instruction fait parfois à son corps défendant figure de justicier. Paradoxalement, il dispose à la fois de trop de pouvoir sur le déroulement de la procédure et d'un manque de pouvoir vis-à-vis du Parquet qui représente le pouvoir exécutif. Ses pouvoirs sont en effet multiples, il est à la fois et tour à tour :
En même temps, sa liberté est entravée par les représentants du pouvoir exécutif. C'est le Parquet qui décide discrétionnairement d'ouvrir ou de ne pas ouvrir une information. Il est lié par le réquisitoire introductif qui l'oblige à n'instruire que sur les faits retenus par le Parquet. Ses investigations doivent être orientées par le Parquet. Il est dépourvu par ailleurs de pouvoir de contrainte ou de sanction vis-à-vis de la police judiciaire.
Ce constat opéré, deux orientations sont envisageables.
La première consisterait à créer une « Chambre des libertés » qui aurait pour compétence de se prononcer sur les questions touchant aux libertés (mandat de dépôt, placement sous contrôle judiciaire, perquisition, etc.) et à laquelle n'appartiendrait pas le juge d'instruction. Il faut séparer l'instruction elle-même des décisions touchant aux libertés. Il est en effet dangereux pour les libertés individuelles que le pouvoir d'instruction soit exercé par un magistrat qui a également le pouvoir de mise en détention et il est par ailleurs choquant qu'un seul magistrat ait aujourd'hui à décider de la détention provisoire, qui peut durer de nombreux mois, alors que plusieurs magistrats doivent siéger pour prononcer une simple peine d'amende.
La seconde solution, qui est pratiquée dans de nombreux pays consisterait à séparer clairement les deux fonctions. Le Parquet, devenu alors indépendant vis-à-vis du Garde des Sceaux serait désormais seul responsable de l'enquête et de la mise en examen. Le juge d'instruction perdrait sa fonction d'enquêteur et de procureur pour exercer la plénitude de la fonction de juge des droits et des libertés. Il se prononcerait en particulier sur les mesures de limitation de la liberté (prolongement de la garde à vue, perquisition, détention, contrôle judiciaire).
Quelle que soit l'hypothèse retenue, les mesures touchant aux libertés n'interviendront qu'après un débat pubic et contradictoire sous le contrôle d'une instance collégiale. Par ces mécanismes de contre-pouvoirs, des garanties réelles seraient ainsi données aux justiciables.
La procédure devant le juge administratif devra elle aussi faire l'objet d'une démocratisation :
élargissement des possibilités de suspension provisoire des actes administratifs contestés, consécration du droit du juge à adresser des injonctions à l'administration.
- La présence de citoyens dans les instances de jugement : tribunaux de commerce, tribunaux civils et correctionnels. Pratiqué dans de nombreux pays, ce système d'échevinage apporte des garanties supplémentaires d'impartialité. Cette formule existe en France pour les tribunaux pour enfants. Elle préserve les juges spécialisés de l'isolement et de la routine. Plus nombreux seraient les citoyens appelés à participer au fonctionnement de la justice, plus accessibles aux justiciables et plus lisibles seraient sans doute les décisions rendues.
— L'obligation absolue des motivations des décisions de justice. Cet impératif légal, trop souvent contourné dans la pratique par des formules passe-partout ou sibyllines, devrait être pleinement respecté sous peine de cassation.
§3 - Une justice moderne
Les magistrats effectuent un travail de grande qualité dans des conditions souvent déplorables.
Les citoyens perçoivent cependant leur justice comme un monde archaïque (il l'est), incompréhensible, inaccessible, onéreux, aléatoire et dont les décisions sont trop longues à intervenir. Une justice proche du citoyen doit être à la fois accessible et rapide. Ces remarques valent notamment pour les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Mais la juridiction pénale n'est pas non plus exempte du reproche de lenteur.
- Une justice accessible et ouverte aux citoyens
Les privilégiés de l'argent, du savoir et du pouvoir sont mieux armés pour suivre le chemin de croix auquel ressemble trop souvent le parcours juridictionnel. Deux obstacles réservent à une minorité l'accès à la justice :
- Une justice plus rapide : La lenteur colle à la peau de la justice : au tribunal de Grenoble, un bas-relief en granit la représente sous la forme d'une tortue.
Un objectif pourrait être retenu par les socialistes : réduire de moitié les délais de jugement au cours de la prochaine législagure. Pour abréger l'insupportable durée des procès ou de l'exécution des décisions de justice, plusieurs remèdes s'imposent :
L'ensemble de ces modifications exigera une augmentation substantielle des crédits du ministère de la Justice.
b) Une cour constitutionnelle
Longtemps rétive à l'examen par un organe juridictionnel supérieur de la conformité des lois à la Constitution, la France s'est progressivement accoutumée à l'existence d'une instance de contrôle de la constitutionnalité des textes adoptés par le Parlement. Quelles qu'en soient ses imperfections, l'œuvre accomplie par le Conseil Constitutionnel a contribué à forger un corps de principe fondé sur la Déclaration de 1789 et les préambules des Constitutions de 1946 et 1958 qui ont amélioré la protection de l'Etat de droit. Les démocrates n'ont pas eu trop à se plaindre d'un Conseil qui n'a pas manqué de censurer certaines atteintes aux Droits de l'Homme.
La réussite de sa mission plaide en faveur de son extension, à l'image des cours constitutionnelles de la plupart des pays d'Europe. Quand François Mitterrand, puis Lionel Jospin dans son programme présidentiel, ont proposé d'ouvrir aux citoyens un droit de saisine du Conseil Constitutionnel à l'occasion d'une procédure juridictionnelle, ils ont par là même exprimé une volonté d'élargissement des fonctions de cette instance. Ainsi, serait plus effectivement garanti le respect des droits individuels et des libertés civiles.
Les transformations à apporter porteraient à la fois sur la composition, la procédure, la saisine et les moyens de travail.
§1 -Le mode de désignation des membres du Conseil Constitutionnel rend l'équilibre interne trop tributaire des alternances politiques. Un système d'élection des membres de la juridiction constitutionnelle par une majorité renforcée (4/5°) des membres du Parlement obligerait les grandes formations politiques à s'entendre sur des choix pluralistes et équilibrés.
Au demeurant, les candidats à cette fonction devraient avoir exercé une profession juridique pendant dix ans au moins.
§2 - La procédure devant la juridiction constitutionnelle devrait être substantiellement modifiée: elle est aujourd'hui secrète, écrite et insuffisamment contradictoire. Cette procédure désormais transparente devrait garantir la loyauté du débat entre les parties et prévoir la tenue d'audiences publiques.
§3 - La saisine
Dans l'esprit de la réforme imaginée par François Mitterrand en 1981 et par Lionel Jospin en 1995, et à l'image d'autres pays d'Europe, le justiciable pourra soulever l'exception d'inconstitutionnalité à tout moment de la procédure juridictionnelle, quitte à reconnaître à la juridiction saisie le droit de rejeter le recours si l'exception apparaît non sérieuse et manifestement dilatoire.
§4 - Les moyens de travail. Indépendamment de l'attribution de nouvelles compétences, le Conseil Constitutionnel souffre d'ores et déjà d'un manque manifeste de moyens humains et matériels. Il va de soi que sa transformation en véritable juridiction constitutionnelle réclamerait a fortiori la mise en place d'une organisation technique solide.
c) La fonction de Médiateur : le « défenseur des droits du peuple »
La fonction de Médiateur donne au citoyen la possibilité de défendre ses droits lorsqu'un abus lui semble avoir été commis par l'administration ou telle autre autorité. Pour accomplir cette mission, le Médiateur français ne dispose pas du même statut moral et juridique que ses homologues d'autres pays européens. En s'inspirant de l'Ombudsman des pays nordiques ou du Défenseur du peuple espagnol, son statut pourrait être heureusement modifié dans le sens suivant :
§ 1 - il serait élu à une majorité renforcée des 4/5" par le Parlement au lieu d'être nommé par le Président de la République ;
§2 - il pourrait être saisi directement par les citoyens et non par les seuls parlementaires ;
§3 - il pourrait initier lui-même une enquête ;
§4 - il jouirait de larges pouvoirs d'investigation ;
§5 - il pourrait même intenter des poursuites contre des fonctionnaires et saisir le juge constitutionnel.
B - LA GARANTIE DES DROITS SOCIAUX
Aujourd'hui, nous devons aller plus loin dans la défense et l'amélioration des conditions de travail de ceux qui ont un emploi stable, mais aussi pour répondre aux inquiétudes et au désespoir de ceux qui subissent la montée du chômage, la précarité, la multiplication des contrats à durée déterminée, du temps partiel, de l'intérim.
C'est le sens d'une démocratie sociale : le renforcement, à tous les niveaux, des pouvoirs de contrôle et de participation des citoyens, des salariés, des chômeurs, de l'ensemble des assurés sociaux sur les décisions qui les concernent, dans l'entreprise, dans les services publics, dans les organismes de la protection sociale, comme dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Cette participation accrue de tous est aussi un gage d'efficacité économique et de dynamisme des entreprises par l'implication des salariés dans le processus de production. Elle ne doit pas mettre en cause l'indépendance des salariés et les organisations syndicales vis-à-vis des directions d'entreprise.
1) Dans le monde du travail
a) Le droit au droit du travail
La première tâche pour restaurer des droits démocratiques dans l'entreprise est d'oeuvrer à une renaissance et un renforcement de la réglementation du travail en direction des 14,5 millions de salariés qui se trouvent dans le secteur privé sans garantie d'emploi.
3,4 millions de salariés travaillent dans 1 million d'entreprises de moins de dix salariés, et 3,7 millions de salariés travaillent dans les entreprises de 11 à 49 salariés, soit environ 7 millions dans des moins de cinquante salariés qui, actuellement n'ont pas le droit d'avoir de Comité d'entreprise, ni même de plans sociaux lorsqu'il y a licenciement.
Il convient de restaurer et d'élargir les droits protecteurs de l'emploi, des conditions de travail, des horaires, de l'application des conventions collectives, à commencer par l'abrogation des lois adoptées par la droite qui ont limité ces droits, et en premier lieu, la loi quinquennale.
Il ne faut plus admettre la précarité en droit ni en fait : ne plus permettre la multiplication des contrats à durée déterminée et leur renouvellement permanent ; ne plus permettre les déréglementations qui nuisent à la santé, à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés. Le contrat à durée indéterminée encadré par le Code du Travail et les conventions collectives doit redevenir la norme.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le droit à réintégration devra être instauré et les moyens devront être donnés aux tribunaux et à l'Inspection du travail pour qu'il soit effectif.
« L'obligation de faire » se substituera à la logique indemnitaire. A cette fin, il faudrait donner plus de moyens à l'Inspection du travail et à la justice prud'homale.
L'Inspection du travail ne compte aujourd'hui que 432 inspecteurs et 712 contrôleurs pour 1,2 million d'entreprises. Par ailleurs, alors qu'il est constaté un million d'infractions par an, 7 000 seulement sont sanctionnées à cause du classement sans suite par le Parquet. Certaines infractions au Code du Travail devraient dès lors comporter des sanctions a minima incompressibles.
La sous-traitance ne doit plus être ignorée par le droit du travail. Son développement est devenu un système de dégradation en cascade des droits et de la sécurité des salariés. Cela doit être arrêté.
b) Le premier degré de l'organisation collective
Dans les petites et moyennes entreprises, nombreuses, où il n'existe aucune représentation du personnel, il a été instauré une institution nouvelle qui a commencé à faire ses preuves : les « conseillers du salarié ». Ceux-ci sont actuellement proposés par les organisations syndicales et sont nommés chaque année par le Préfet : ils figurent sur une liste disponible en Mairie ou à l'Inspection du travail. L'employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable au licenciement est tenu de l'informer qu'il peut se faire accompagner par un de ces « conseiller du salarié ». Nous proposons d'étendre le nombre et les moyens des « conseillers du salarié ».
§1 - Leur nombre doit être élargi de façon substantielle pour qu'ils puissent faire face aux demandes émanant de toutes les entreprises de moins de dix salariés et des entreprises de plus de dix salariés qui n'ont pas de Délégué du personnel ni de Comité d'entreprise.
§2 - Leurs moyens en terme de formation, de crédits d'heures et de remboursement, actuellement insuffisants pour jouer leur rôle, doivent être accrus.
§3 - Leurs prérogatives doivent être élargies : ils doivent pouvoir intervenir désormais sur les questions qui concernent l'application des conventions collectives, les modifications des horaires de travail, les risques majeurs en matière d'hygiène de travail, en amont des sanctions disciplinaires. Les moyens de les contacter doivent être affichés dans toutes les entreprises concernées.
c) La représentation des salariés dans l'entreprise
Beaucoup reste à faire pour renforcer la représentation des salariés tant par les institutions représentatives du personnel que par les syndicats.
§1 - Les moyens et prérogatives des institutions représentatives du personnel seront renforcés aux différents niveaux et les dispositions de la loi quinquennale qui en limite le nombre, les moyens et les pouvoirs seront abrogées :
De façon générale, les obstacles mis par les employeurs au fonctionnement des Institutions représentatives du personnel seront non seulement plus sévèrement sanctionnés mais là encore, les décisions de l'Inspection du travail pourront les «obliger à faire », c'est-à-dire à respecter le Code du Travail.
Au-delà, se pose la question des seuils. En tout état de cause, pour combattre le contournement des seuils, les mécanismes de reconnaissance d'une unité économique et sociale devront être confiés à l'Inspection du travail. Les critères de reconnaissance de telles unités, et de groupes, devraient être assouplis, de façon à empêcher les fraudes à la loi par le morcellement des entreprises en établissements distincts artificiels, alors qu'elles sont dirigées par et dans l'intérêt des mêmes personnes physiques et morales.
De même sera organisée la mise en place de délégués de sites afin de prendre en compte les salariés des petites et moyennes entreprises et pallier l'absence de sections syndicales d'entreprise dans ces établissements.
Parallèlement, il y a lieu de renforcer les moyens et la formation de ces représentants. Ils doivent bénéficier de solides moyens d'information pour pouvoir exercer un véritable contrôle sur la vie de l'entreprise et les décisions qui intéressent les salariés. Ils doivent bénéficier d'une formation conséquente ; aujourd'hui par exemple, un membre du comité d'entreprise, nouvel élu, ne dispose que d'une semaine de formation obligatoire. Ceci est totalement insuffisant pour lire un bilan ou travailler avec un expert. Il convient d'augmenter le temps, la qualité, le financement et la périodicité de la formation des élus du personnel.
Une concertation devra être engagée avec les organisations syndicales sur la question de la représentation des salariés dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance des entreprises privées.
Dans l'administration, des dispositions semblables doivent être prises pour les Comités techniques paritaires.
Enfin, sur les décisions concernant la durée du travail, les conditions d'hygiène et de sécurité, l'application des conventions collectives, le comité d'entreprise qui est déjà obligatoirement consulté disposera, au terme de la procédure, du droit de saisir l'Inspection du travail qui peut provoquer une nouvelle convocation du Comité d'entreprise sur la base de ses propositions. Cette saisie est suspensive de la mise en œuvre des mesures.
§2 - Le syndicat : pour conforter le syndicalisme, l'exigence d'un principe de représentativité majoritaire des signataires de conventions collectives devrait être définie. La formation des négociateurs justifierait des moyens renforcés (voir également supra p.30).
d) Un système efficace de contrôle des licenciements
Chacun se souvient de l'explication habituelle du CNPF sur l'augmentation des formes précaires d'emplois en raison de l'impossibilité de procéder librement aux licenciements économiques.
Or, tout le monde peut constater aujourd'hui qu'aucune création d'emploi n'a accompagné la suppression de l'autorisation administrative de licenciement en 1986 et que les emplois précaires ne cessent d'augmenter au point de représenter 80 % des contrats de travail signés chaque année.
Lors de la précédente législature, nous avons tenté de trouver une réponse dans le renforcement du plan social d'accompagnement et dans le contrôle de ce plan confié aux juges.
Au moment où les socialistes réfléchissent aux orientations qu'ils proposeront aux Français, la question du renforcement du contrôle des licenciements ne peut être esquivée !
Chaque année, des centaines de milliers de licenciements ont lieu. Pendant ce temps là, on constate un recours systématique aux heures supplémentaires et aux formules précaires.
C'est pourquoi il est d'abord nécessaire de donner les moyens aux salariés et à leurs représentants d'être informés complètement et à temps des décisions stratégiques qui les concernent. Il faut aussi que la négociation sur les décisions soit effective et que les représentants des salariés disposent pour cela du temps et des moyens appropriés.
Il faut enfin améliorer la législation existante pour mieux rééquilibrer le rapport des forces aujourd'hui encore trop défavorable aux salariés.
L'idée est d'établir un véritable contrôle des licenciements : aussi au terme des consultations avec les instances qualifiées du personnel, l'inspection du travail est obligatoirement saisie. Elle a la possibilité de refuser les licenciements. Cette décision est susceptible des recours prévus par la loi.
Ce contrôle sera une façon forte d'arrêter le chantage à l'emploi, de permettre aux salariés de mieux défendre leurs droits élémentaires et de rendre aux pouvoirs publics qui sont concernés au premier chef, la maîtrise des conséquences financières, sociales des exclusions du marché du travail.
e) La surveillance par les salariés
Au sein des entreprises, le recours aux nouvelles technologies n'a plus seulement pour objet de rationaliser la gestion, de mieux maîtriser les coûts, d'accroître la productivité ou de renforcer la sécurité.
Divers dispositifs, tels que les autocommutateurs téléphoniques ou les systèmes d'enregistrement des date et heure de connexion aux applications informatiques, peuvent concourir, de manière imperceptible, à un renforcement de la surveillance des salariés et à la mise en place de procédures de contrôle automatisés, permanentes et systématiques.
En outre, ces systèmes permettent aux employeurs de disposer d'informations dont l'utilisation détournée pourrait porter préjudice aux salariés.
Pour éviter les risques de dérive, il est nécessaire de renforcer la protection des salariés en assurant un meilleur respect des lois Aubry et en donnant à la C.N.I.L. des moyens plus efficaces pour intervenir.
f) Pour un droit social européen
Le développement de la démocratie sociale au niveau européen passera par l'obligation réelle d'appliquer le protocole social du Traité de Maastricht dans l'ensemble des pays de l'Union et par le développement d'un droit social européen de haut niveau incluant un salaire minimum européen.
Une directive du Conseil le 22 septembre 1994 institue la possibilité de constituer des comités d'entreprises européens. Elle ne s'applique qu'aux groupes d'entreprises employant au moins mille travailleurs dans les Etats membres et dans au moins deux Etats différents, avec au moins cent cinquante travailleurs dans chacun d'eux.
La directive ne précise pas le contenu de l'information ni les attributions ou la composition du comité d'entreprise. Elle laisse ces matières à la négociation d'un accord. Par contre, elle impose un devoir de confidentialité aux représentants des salariés.
Les Etats ont trois ans (Jusqu'au 22 septembre 1996) pour s'y conformer. Trente-trois comités européens d'entreprise auraient déjà été créés sur base volontaire fin 1994.
Il convient d'élargir la mise en place systématique des Comités d'entreprise européens avec des droits d'information, d'expression et de contrôle aligné sur le droit le plus élevé des différents pays concernés.
2) Dans la société
La protection des libertés individuelles ne suffit pas. Comment être pleinement citoyen lorsque l'on n'a pas de logement, ou que l'on est exclu de fait de l'accès aux soins ou à la justice, ou que l'on est dans une situation de chômage prolongé, sans espoir de s'en sortir ? C'est aujourd'hui la situation de millions de personnes. C'est inacceptable parce que c'est injuste mais aussi parce que cela fragilise la démocratie.
Pour les socialistes, développer la citoyenneté, c'est aussi tout mettre en œuvre pour permettre un accès à tous à des garanties sociales. Cela impose de fixer comme priorité de notre action politique, l'accès concret aux droits sociaux fondamentaux.
La première condition est une bonne information sur ceux-ci. L'action des municipalités, des services publics, des associations dans ce domaine est fondamentale. Nous leur en donnerons les moyens.
Ensuite, il est indispensable de simplifier nombre de prestations et les procédures d'accès, en matière de prestations familiales, d'aide médicale par exemple. La simplification des procédures administratives n'est en effet pas réservée aux employeurs. Il faut renforcer et redéployer les services publics sur le territoire (la police, l'ANPE, la poste par exemple) afin de garantir un véritable accès à tous.
L'accès concret aux droits sociaux fondamentaux se fera aussi en luttant contre les phénomènes de désaffiliation sociale et civique. Il est proposé de :
Enfin, si des formes de représentation sociale existent d'ores et déjà dans les institutions ou les divers dispositifs, elles se sont avérées insuffisantes.
Des propositions peuvent être soumises au débat avec l'ensemble des partenaires notamment syndicaux :
a) assurer la présence des associations de retraités à titre consultatif au sein des différents conseils d'administration qui les concernent au plan national et dans les collectivités locales de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ainsi que du conseil national des retraités et personnes âgées (CNRPA) ;
b) rendre obligatoire la création d'instances gérontologiques locales chargées de coordonner les actions de prise en charge des personnes âgées dépendantes ;
c) élargir la représentation des usagers ou de leur famille dans les conseils d'administration des établissements d'accueil de personnes âgées ou handicapées qu'ils soient publics, privés lucratifs, ou privés à but non lucratifs. Et surtout vérifier l'effectivité de cette représentation et instaurer une structure d'appel ;
d) faire évoluer la composition des Comités départementaux d'insertion en favorisant la désignation des représentants associatifs (étendre ces dispositions aux Commissions locales d'insertion) ;
e) garantir la présence dans chacune des instances d'insertion de représentants des allocataires notamment du RMI sur proposition d'organisations représentatives ;
f) associer les organisations de chômeurs à la gestion des fonds sociaux de l'ASSEDIC, au Conseil d'administration de l'UNEDIC ;
g) proposer la création de conseils communaux ou intercommunaux pour l'emploi et la prévention de l'exclusion sociale, véritables CES locaux qui permettent la coordination locale des actions de lutte contre l'exclusion, coordonnent les actions en faveur de l'emploi et la vérification de l'application effective de certaines mesures :
comme les clauses sociales dans les critères additionnels ou obligatoires des appels d'offres pour les marchés publics, le contrôle social sur l'ensemble des mesures d'aide à l'emploi ou à l'insertion professionnelle, la création de structure d'épargne solidaire en soutien aux entrepreneurs sociaux, la définition de la stratégie d'accompagnement social, etc. ;
h) instaurer un Conseil départemental de développement social comme il était prévu dans la loi de décentralisation de l'action sanitaire et sociale.