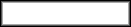
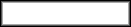
CONCLUSION
1) Le Parti Socialiste prolongera la Convention « Les Acteurs de la Démocratie » par de nouvelles initiatives
L'émotion profonde qui a marqué la disparition de François Mitterrand, l'enthousiasme autour de la campagne présidentielle de Lionel Jospin au printemps 1995, la force collective exprimée lors du mouvement social de décembre ont révélé que, face au pessimisme et à la toute puissance du libéralisme, restent présentes dans le peuple, chez les sympathisants et dans les cœurs de nos militants, des valeurs communes qui cimentent le socle de la gauche.
Ces trois événements ont démontré que la volonté de transformation sociale que les socialistes ont pour mission d'incarner est toujours là, prête à se mobiliser.
Fort de cette responsabilité, le Parti Socialiste a engagé une réflexion approfondie pour élaborer de nouvelles propositions qui doivent être à la fois à la hauteur des attentes d'un vrai changement et suffisamment construites pour ne pas les décevoir demain.
Mais s'il convient ainsi de faire fructifier ces moments forts de 1995, nous ne pouvons oublier qu'il y a eu aussi 1993. Les mécanismes qui ont conduit au renoncement face aux forces du marché, au sentiment d'une coupure entre le peuple et ses dirigeants, bref, à une insuffisance de sincérité et de conviction, doivent être analysés, car ils ont été sanctionnés par l'opinion toute entière, et au premier rang par notre électorat.
C'est avec ce regard lucide sur ce passé récent que le Parti Socialiste, tirant les leçons de la difficulté de notre démocratie à prendre en charge les problèmes concrets des gens, a choisi de mener une profonde réflexion sur les acteurs de la démocratie. Nous sommes à cet effet conscients d'un fait essentiel : pour porter le changement social, pour affirmer la volonté de construire un monde plus juste et meilleur, le premier des acteurs de la démocratie, c'est le Parti Socialiste, ses militants, ses sympathisants, ses responsables.
Encore faut-il que dans ses forces intérieures, il s'affirme comme cet acteur politique du changement social.
Pour cela, à l'écoute de la gauche toute entière et de l'ensemble des forces socialistes, nous devons développer une capacité à imaginer et à formuler des propositions nouvelles, incarnant les aspirations de la société française. Tel est le sens de nos propositions.
Les porter au bout de l'action, c'est aussi garantir qu'elles seront appliquées et permettront dès 1998 un vrai changement social, en rupture par rapport à la société. A cet effet, le Parti Socialiste propose d'établir un contrat clair et volontaire avec les Français qui peut être formulé ainsi :
Notre volonté n'est pas d'améliorer à la marge une société qui, en l'état, n'est pas satisfaisante car elle produit plus que jamais exclusions et reculs sociaux.
Notre volonté est de modifier profondément les règles du jeu d'une société qui, dans son fonctionnement quotidien, se révèle de plus en plus injuste.
Nous ne devons pas craindre de renouer avec des convictions, de les affirmer en adoptant une posture politique franche, de porter le projet d'une société nouvelle :
- faire preuve de conviction, c'est conserver intacte notre capacité d'indignation qui fonde l'engagement à gauche, c'est savoir se passionner pour passionner le débat démocratique, c'est opposer au cynisme, à l'usure et à la lassitude, l'enthousiasme et l'ardeur à bâtir une société plus juste ;
- traduire dans une posture politique franche, c'est affirmer que le Parti Socialiste a avant tout pour rôle d'incarner le mouvement social sur le champ politique, conservant ses liens avec lui, y puisant sa force ;
- rassembler nos valeurs et nos propositions dans un projet, c'est considérer qu'au-delà des obstacles et des contraintes qui ne manqueront pas de freiner la réalisation de nos aspirations, il nous faut dessiner une ligne d'horizon comportant la part de rêve et d'utopie nécessaire à la mobilisation pour de nouvelles conquêtes démocratiques et sociales.
Notre devoir est là. Nous ne pouvons abandonner la conquête d'un avenir de progrès. Nous ne pouvons gouverner sans bâtir une société plus juste.
Le programme c'est ce que nous pouvons faire dès 1998. Pour refonder la crédibilité de la politique, il faudra dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit.
Le projet, ce sont nos valeurs, la ligne d'horizon, les pistes nouvelles sur lesquelles il nous faut d'ores et déjà réfléchir.
Opposer le programme au projet, c'est opposer les socialistes à eux-mêmes, c'est opposer ses militants à ses responsables et demain les gouvernants aux gouvernés.
Dès maintenant, le PS doit prendre l'initiative de débats publics, partout, sur des sujets qui intéressent la société (immigration, drogue, organisation du temps de vie et du travail, enjeux de la société de l'information, fiscalité...). Ces débats doivent être ouverts à l'ensemble des forces sociales, des mouvements, des associations.
Le PS se donne par ailleurs pour objectif dans l'année à venir de définir les droits fondamentaux, et les modalités effectives de l'accès de tous à ceux-ci, qui pourraient figurer dans une Charte applicable à tous les citoyens. Il organisera pour ce faire, dans tous les domaines concernés (santé, éducation, emploi, logement, droits de l'homme, sécurité...), une large consultation des institutions, associations, et mouvements.
Le PS demande à tous ses élus locaux et principalement les maires, de favoriser la participation et l'expression des habitants en recherchant les moyens appropriés pour donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Il les invite, dès maintenant, à engager l'enrichissement et la clarification des relations avec les associations, notamment par la contractualisation.
Le PS demande aux maires socialistes des villes de 10 000 habitants de mettre en place des conseils de quartiers et, dans les grandes villes des Conseils économiques et sociaux. Il tirera les leçons des expérimentations au bout de dix-huit mois pour envisager une intervention législative rendant obligatoire ces conseils.
Rapprocher les institutions des Français ne sera possible qu'à la condition de donner à notre engagement politique la dimension éthique que nos concitoyens attendent de nous. La politique n'est pas l'éthique, mais elle doit être éthique au risque de perdre son sens. C'est encore bien plus vrai pour la démocratie qui est toujours l'histoire d'un contrat instruit dans l'échange et la confiance.
2) La démocratie n'est pas une source de faiblesse, mais d'efficacité
Pour indispensables qu'elles soient, les réformes institutionnelles ne sauraient suffire à redonner un souffle nouveau à notre vie publique.
La démocratie, ce ne sont pas seulement des textes, c'est aussi une manière d'être, un comportement, une pratique du pouvoir. Les femmes ou les hommes qui ont en charge des responsabilités publiques doivent par leur exemple montrer le chemin : modestes pour eux-mêmes mais ambitieux pour leur pays.
Une démocratie renouvelée réclame aussi des politiques publiques fortes, fondées sur la volonté de justice et de croissance.
Elle a surtout besoin d'un élan populaire, d'une dynamique de changement d'un nouveau contrat social. Alors les citoyens en deviendront les participants actifs et responsables. Leurs droits nouveaux auront pour corollaire leurs devoirs civiques vis-à-vis d'une société dont ils seront à la fois les bâtisseurs et les bénéficiaires.
C'est à ce prix que la démocratie dont nous rêvons sera pour notre pays une source de renouvellement et de développement. Elle sera alors une force précieuse.
Contrairement à certaines idées reçues, la démocratie n'est en effet pas un luxe. Elle n'est pas un supplément d'âme dont il ne faudrait s'occuper qu'après avoir réglé les vraies questions : la croissance économique et la justice sociale. En réalité, elle est inséparable de ces deux autres piliers d'une société moderne.
Pour produire efficacement des richesses, pour les répartir justement entre tous, il faut un système légitime qui organise les droits et devoirs réciproques des citoyens les uns envers les autres. Si la puissance économique et la justice sociale sont les briques de la maison commune, la démocratie est le ciment qui les tient ensemble, ou plus exactement, elle n'est pas seulement la fin d'un projet de civilisation, elle en est aussi le moyen.
Il suffit, pour le comprendre, de mesurer les formidables progrès de la croissance et de la redistribution depuis que la démocratie a pris son plein essor dans les pays occidentaux. Ce n'est pas une coïncidence. Pour qu'il y ait création de richesses, il faut qu'il y ait liberté de penser, de s'exprimer, d'entreprendre et sécurité juridique des relations entre les individus. Pour qu'il y ait juste répartition des richesses, il faut qu'il y ait expression des besoins collectifs et transaction pacifique entre les intérêts opposés.
Dès lors, il paraît évident que si nous voulons avancer vers plus de richesse et une meilleure répartition de celle-ci, il faut, du même pas, avancer vers plus de démocratie. L'idéal humaniste est un idéal d'accomplissement de l'homme sur cette terre. Une démocratie plus achevée est à la fois plus conforme aux valeurs de civilisation et aux impératifs d'efficacité.
Pour une part, cet accomplissement démocratique est un rêve. Le pouvoir total et permanent des citoyens sur eux-mêmes est hors de portée de nos sociétés nombreuses, multiples et complexes, qui requièrent nécessairement des médiations. Il y a dans l'idéal démocratique une part d'utopie. Non seulement ce n'est pas une contre-indication, mais c'est un argument supplémentaire en sa faveur. La démocratie totale, absolue, intégrale est comme la ligne d'horizon qui s'éloigne à mesure que l'on croit se rapprocher d'elle. Mais c'est cela qui nous fait avancer et progresser. Puisque c'est une utopie pacifiste, il est bon et nécessaire qu'elle nous anime et nous réunisse. C'est toute la force de l'idéal démocratioque : il garantit, par ses réalisations concrètes, la réussite collective d'un peuple ; et en même temps, il l'élève à la hauteur d'exigences universelles par lesquelles le peuple se projette dans l'avenir.
S'il était besoin d'une preuve supplémentaire et concrète de l'efficacité d'une démocratie en marche, la décentralisation nous l'offrirait. En libérant l'initiative des élus et des citoyens, elle a fait circuler un sang nouveau dans le tissu social de la Nation. Le paysage économique et politique du pays s'est transfiguré et modernisé. Un exemple parmi d'autres de ce changement : plus personne n'oserait employer aujourd'hui une expression qui avait court jusque dans les années 75 : « Le désert culturel français ». Sous l'impulsion de l'Etat (le plan Universités 2000, une nouvelle politique culturelle et scientifique, la rénovation des lycées et des collèges), les élus locaux ont été les artisans d'un véritable aménagement culturel du territoire. Partout en France - des grandes villes aux communes moyennes, des régions urbanisées aux départements ruraux -, une renaissance de la vie intellectuelle et scientifique a été favorisée par la multiplication des centres d'art, la modernisation des universités et des établissements d'enseignement, la création de laboratoires de recherche...
C'est cette même ardeur démocratique qui nous permettra de gagner les batailles économiques et sociales du futur. Le pouvoir politique ne réussira à vaincre les résistances au changement et au progrès que s'il est relégitimé par une confiance populaire constamment renouvelée. Face aux autres pouvoirs (les groupes multinationaux, les médias, les marchés financiers...), il ne pourra imposer sa volonté propre que par un surcroît de démocratie. Du peuple, il tiendra sa vraie autorité et son inspiration. Cette politique nouvelle n'aura de chance de porter ses fruits que si, à tout moment, le pouvoir politique est décidé à mettre en mouvement les intelligences, les talents, les cœurs et à associer l'ensemble des forces du pays à la conception et à la mise en application de ses actions.