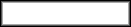
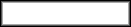
INTRODUCTION
Nous vivons la démocratie comme nous respirons : sans y penser. Elle nous paraît être là et devoir être là de toute et pour toute éternité. Rien n'est moins vrai.
Construction récente au regard de l'histoire de l'humanité, née sur la terre de Grèce au Ve siècle avant notre ère, elle a connu par la suite une éclipse de deux millénaires.
C'est contre l'ordre établi par les puissants qu'elle s'est ensuite construite, parfois dans le sang, toujours dans la souffrance. En France même, il aura fallu attendre près d'un siècle après la révolution pour que la République l'emporte.
Cette démocratie, si chèrement conquise, est toujours fragile. En mutation continue, elle est sans cesse à consolider et à moderniser. Bref, à réinventer.
Elle est le système le plus efficace et le plus juste que les hommes aient découvert pour organiser leur manière de vivre ensemble en société.
Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, elle seule permet de fonder une ambition collective, un projet commun, non sur la négation mais, au contraire, sur l'épanouissement des individus, de leurs droits et de leurs libertés. Bref, de concilier la poursuite des bonheurs particuliers et l'accomplissement de l'intérêt général. Sa solidité, son efficacité tiennent précisément au fait qu'elle repose, non sur la contrainte, mais sur l'adhésion, non sur la force de quelques-uns, mais sur la volonté de tous.
Or, la France connaît aujourd'hui un malaise démocratique. Les citoyens, de plus en plus, se détournent de la chose publique ou se retournent contre elle. Cela s'explique largement par la montée du chômage et des exclusions, conséquences du système économique dominant. C'est la mission historique de la gauche, pour peu qu'elle sache renouer avec ses traditions en leur donnant un visage nouveau, que de redonner force et vitalité à l'espérance démocratique. Alors cet idéal d'épanouissement individuel et collectif redeviendra une promesse d'avenir.
1er chapitre de l'introduction : la démocratie : un combat de toujours pour la gauche
2e chapitre de l'introduction : un combat d'aujourd'hui et de demain pour la gauche
1er CHAPITRE DE L'INTRODUCTION:
I - L'HISTOIRE DE LA GAUCHE SE CONFOND AVEC L'HISTOIRE DES LIBERTÉS
A - D'ABORD PAR SES LUTTES : LA DÉMOCRATIE INTÉGRALE
LA DEMOCRATIE : UN COMBAT DE TOUJOURS POUR LA GAUCHE
Depuis l'acte inaugural de 1789 jusqu'à la révolte joyeuse de mai 1968 et la victoire du 10 mai 1981, en passant par les Canuts, les barricades de 1830, celles de 1848, la Commune et l'Affaire Dreyfus, les grandes lois de liberté et de laïcité de la IIIe République, le Front Populaire, la Résistance et le mendésisme avec son œuvre décolonisatrice, « liberté » est l'autre nom de la France.
C'est aussi l'autre nom de la gauche, parti du mouvement qui fut, dans la rue ou dans les urnes, souvent le précurseur, toujours l'acteur, de ces accélérations de l'histoire démocratique.
L'émancipation de l'homme est à l'épicentre de ce tremblement de terre que la gauche s'ingénie à introduire contre l'ordre établi. La démocratie, la démocratie réelle, la démocratie intégrale pourrait-on dire, qui prend en compte l'ensemble des dimensions de l'homme en société — l'économie, le social, la culture, la politique - est le visage de ce combat immémorial de la gauche.
« Liberté » est l'autre nom de la France C'est aussi l'autre nom de la gauche
Depuis l'époque où elle s'identifiait à la Révolution, en lutte contre les forces réactionnaires d'Ancien Régime, jusqu'à celle où elle devient le socialisme en lutte contre les forces injustes du conservatisme, en passant par ce long temps où elle défendait la République, la gauche, parfois comme législateur, le plus souvent comme force de combat à travers la mobilisation et la contestation politique ou syndicale, a aidé le peuple de France à conquérir la souveraineté populaire et les libertés et droits individuels et collectifs. Jamais aucune liberté ne fut octroyée de bonne grâce par les conservateurs au pouvoir. Chaque fois elle fut conquise de haute lutte. Combien de travailleurs licenciés, emprisonnés, parfois même massacrés avant que le droit de grève par exemple ne soit reconnu ?
B - MAIS AUSSI PAR SES RÉALISATIONS
Les lois fondatrices de la liberté de la presse, de la liberté syndicale, municipale, de la liberté de réunion sont l'œuvre des républicains vainqueurs des monarchistes, après 1879. La gratuité de l'école publique obligatoire demeure le symbole de la fondation républicaine. La liberté d'association, la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et donc la liberté de conscience, prolongent et amplifient, grâce aux gouvernements de défense républicaine et du bloc des gauches, la victoire de la République.
Cette œuvre s'est poursuivie au XXe siècle à travers la gauche de gouvernement. Mesure-t-on encore aujourd'hui à sa juste ampleur ce que furent les victoires du Front Populaire : la semaine de quarante heures et les premiers congés payés, les conventions collectives et les délégués ouvriers, la démocratisation de la culture et les premières femmes ministres du gouvernement de la République ? Bref, l'instauration d'un nouveau contrat entre le peuple ouvrier et la République, et d'une nouvelle vision du travail salarié.
Un peu plus tard, après la Seconde Guerre mondiale qui écrasa l'homme et sa dignité, ce sont les premières décisions, dans le prolongement des programmes du CNR, des gouvernements de la Libération (où, sous la Présidence du Général de Gaulle, socialistes et communistes étaient prépondérants) : le droit de vote des femmes, la reconnaissance des droits sociaux par le préambule de la Constitution de 1946, la création d'un régime général de protection sociale, l'instauration des comités d'entreprise.
Autant de textes qui, arrachés par les combats d'hier sont devenus les droits fondamentaux d'aujourd'hui.
1981, l'alternance au cœur de la République
La conquête des libertés a franchi, avec François Mitterrand, une étape nouvelle, la gauche bénéficiant d'une durée d'action qui avait jusqu'alors fait défaut. A elle seule, la présence de la gauche au pouvoir pendant quatorze ans pour la Présidence de la République, et dix ans pour l'Assemblée Nationale et le Gouvernement, introduit une rupture positive dans l'histoire politique du pays, installant l'alternance au cœur des mécanismes de la République. Ainsi la gauche au pouvoir n'est-elle plus « une anomalie éphémère, un accident de parcours ou un mal à prendre en patience » (F. Mitterrand). Une moitié du peuple, exclue de l'exercice du pouvoir par le monopole gouvernemental dont bénéficiaient les forces conservatrices, a conquis, enfin, au sens propre, droit de cité.
Une œuvre législative considérable mais inachevée
A cette avancée vers davantage de représentativité de nos institutions s'ajoute une œuvre législative abondante : la libéralisation des radios et des télévisions, la décentralisation, l'abolition de la peine de mort et des tribunaux d'exception, la reconnaissance de la juridiction de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, les lois Roudy et Neiertz relatives aux droits des femmes, la suppression des discriminations à l'encontre des homosexuels, le financement public des partis politiques et les lois anti-corruption, les nouveaux droits sociaux (la cinquième semaine de congés payés, la semaine des trente-neuf heures, la retraite à soixante ans, le RMI) et les lois Auroux... L'oeuvre est considérable, même si elle est inachevée et parfois trop timide.
La libération des esprits et des mentalités
Et elle ne se limite pas aux innovations législatives et réglementaires, tout observateur impartial en conviendra. Pendant ces années 1980, c'est l'atmosphère, ce sont les mœurs qui ont profondément changé.
Mais on oublie trop souvent que ces années furent aussi celles de la « liberté reine », non pas sous le visage d'une explosion aussi vive que fugace en 1830, en 1848, en 1871 ou en 1968, mais sous celui d'une transformation durable et en profondeur de nos habitudes et attitudes collectives.
En une décennie, on aura vu s'épanouir les contre-pouvoirs tenus jusque-là en lisière : des collectivités locales dotées de véritables compétences, des médias libres et volontiers insolents à l'égard des puissants, des juges conquérant, de fait sinon de droit, leur indépendance.
Le regard sur l'égalité hommes/femmes, sur les rapports parents/enfants, sur les minorités sexuelles, ethniques, religieuses se sera profondément modifié, à la faveur d'une plus grande liberté de parole et d'une plus réelle tolérance. Le combat humanitaire aura fait irruption sur la scène publique.
Bref, la France se sera arrachée à cette gangue conservatrice qui la distinguait de la plupart de ses voisins européens et dans laquelle mai 68 avait déjà ouvert une première brèche. Ce mouvement a été d'une rapidité et d'une ampleur étonnantes.
La victoire de mai 1981 a donc fait franchir à la France un triple pas sur le chemin de la modernisation démocratique : un pas proprement politique avec l'alternance, un pas juridique avec l'œuvre législative des socialistes, un pas « sociétal » avec l'émancipation des contre-pouvoirs et les progrès des mentalités.
II - A TRAVERS CETTE LUTTE CONSTANTE DE LA GAUCHE, LE SOCIALISME FRANÇAIS A IMPOSÉ LA DOUBLE SINGULARITÉ DE SON MESSAGE
A - PAS DE LIBERTE VRAIE SANS PROGRÈS DE LA JUSTICE SOCIALE
Par opposition aux forces conservatrices, la gauche ne conçoit pas la liberté sans la solidarité, ni les progrès de l'égalité civile ou politique sans le recul des inégalités sociales, encore moins la démocratie formelle sans la démocratie réelle. Elle n 'est pas seulement démocrate elle est sociale-démocrate.
Comment concilier l'idéal d'une société organi-sée, pour plus de justice et d'égalité, et le respect des libertés individuelles ? Nul mieux que Jaurès ne sut exprimer et servir cette double exigence :
préserver les droits élémentaires issus de la République (suffrage universel, parlementarisme, laïcité) et chercher à promouvoir sans relâche les droits économiques et sociaux. Ici aux côtés de Dreyfus, de Waldeck Rousseau ou du petit père Combes ; là avec les mineurs de Carmaux : c'est le même homme, la même idée !
De Jaurès, les socialistes ont appris de la démocratie à ne rien retrancher. Ses paroles, vibrantes et fortes, sonnent toujours vraies :
« Si nous allons vers l'égalité et la justice, ce n 'est pas aux dépens de la liberté ; nous ne voulons pas enfermer les hommes dans des compartiments étroits, numérotés par la force publique. Nous ne sommes pas séduits par un idéal de réglementation tracassière et étouffante. Nous aussi, nous avons une âme libre ; nous aussi, nous sentons en nous l'impatience de toute contrainte extérieure. »
Et Jaurès d'évoquer alors « l'ordre social rêvé par nous » dans lequel « la liberté, la vraie, la pleine, la vivante liberté... de chanter et délirer même sous les cieux, de respirer de larges souffles... ».
Précieux enseignement qui guidera le choix des socialistes au moment de la grande lueur à l'Est lorsqu'on cherchera à opposer pluralisme politique et changement social.
B - PAS DE SOCIALISME SANS LIBERTÉ
Au lendemain de la chute du Mur de Berlin, les socialistes peuvent revendiquer fièrement leur constance et leur attachement aux libertés si fortement exprimées par Blum dans son discours au Congrès de Tours.
Par opposition aux tenants d'un socialisme autoritaire ou messianique, œuvre d'une avant-garde éclairée qui détiendrait la vérité de l'Histoire, la gauche socialiste ne conçoit pas la solidarité sans la liberté, y compris la liberté économique. A ses yeux, si les principes fondamentaux de la démocratie l'Etat de droit, la souveraineté populaire et l'équilibre des pouvoirs — ne sont pas les conditions suffisantes d'une société juste, ils n'en sont pas moins les conditions nécessaires et / 'horizon indépassable de notre temps.
Pas de liberté vraie sans progrès de la justice sociale, mais pas de vrais progrès de la justice sociale sans liberté : telle est donc l'originalité du message socialiste.
III - A L'INVERSE, UNE BONNE PARTIE DE LA DROITE FRANÇAISE A TOUJOURS ÉTÉ REBELLE AUX AVANCÉES DES LIBERTÉS ET DES DROITS DES CITOYENS
Certes, la gauche n'a pas le monopole des libertés, ni ne prétend être le légataire unique de l'héritage républicain. Reconnaissons, par exemple, à Valéry Giscard d'Estaing et certains de ses ministres (Simone Veil), le mérite d'avoir proposé les lois sur la majorité à dix-huit ans ou l'I.V.G.
Mais de manière générale, sur la longue période, si la droite proclame aimer les libertés économiques - encore qu'elle puisse être, à l'occasion, l'avocat des rentes ou privilèges de ses clientèles électorales , elle regarde avec circonspection les progrès des libertés et des droits civils, civiques, politiques et sociaux.
Une droite autoritaire
Parti de l'ordre contre le parti du mouvement, la droite est le plus souvent conservatrice, voire réactionnaire, en matière de mœurs. Sur la place des femmes, la place des minorités, les sexualités, bref, sur les grandes questions de société, le plus souvent, elle est l'avocate d'une supposée majorité morale qui ne dit pas son nom.
Elle est autoritaire en matière d'institution : de 1958 à 1981, le Parlement fut entravé, les médias muselés, la justice maintenue en situation d'immaturité, les collectivités locales ignorées cependant que de loin en loin apparaissaient des lois répressives ou régressives, dont la loi « Sécurité et Liberté » demeurera l'emblème.
A nouveau depuis 1993, le vrai visage de la droite répressif et sectaire — resurgit : la reprise en mains des médias et de la presse, la mise au pas de la justice, le recul de la négociation collective, l'adoption des lois Pasqua, la privatisation d'entreprises nationales au bénéfice « d'amis » du pouvoir, le retour du cynisme international (les droits de l'homme en Chine, en Iran).
Réactionnaire en matière de mœurs, autoritaire en matière d'institutions, la droite est, enfin, régressive en matière de justice sociale : hier, elle supprimait l'impôt sur les grandes fortunes (1986) ; aujourd'hui, elle cloue les pauvres au pilori sous prétexte de lutte contre la fraude à l'allocation chômage ou au RMI. Les organisations de travailleurs, le droit social et le droit du travail ne sont pas pour elles des moteurs et formes du progrès, mais des entraves tatillonnes et bureaucratiques à la libre entreprise !
La démocratisation de la société, l'extension des droits et des libertés, le « libéralisme » en matière de mœurs ne sont pas le fonds de commerce de la droite, loin s'en faut. Ils sont en revanche au cœur du projet de la gauche. Cette intimité essentielle de la gauche avec la liberté n'est pas seulement un patrimoine historique qui se visiterait comme un musée. La liberté n 'est pas un lieu de mémoire. Elle est un combat sans cesse à recommencer.
2e CHAPITRE DE L'INTRODUCTION:
I - LA DÉMOCRATIE EN CRISE
LA DEMOCRATIE : UN CHANTIER A REPRENDRE
Tout pourrait porter à croire que l'univers démocratique est un univers apaisé, que nous avons atteint, en la matière, la fin de l'histoire. En réalité, il est un paradoxe dont nous sommes les témoins : jamais la démocratie n 'a paru mieux établie ; et cependant, elle demeure éminemment fragile, menacée non d'explosion, comme hier, mais d'implosion, minée qu'elle est par l'exclusion et le désenchantement civique. Il faut identifier les causes de ce malaise démocratique pour pouvoir y porter remède, conformément à la vocation historique de la gauche.
A - JAMAIS LA DÉMOCRATIE N'A PARU MIEUX ÉTABEIE
1) Elle a conquis de nouveaux et d'immenses territoires dans le monde.
Le basculement des pays de l'Est vers la liberté en 1989, le retour ou l'avènement de la démocratie dans de nombreux pays d'Amérique Latine et de plusieurs nations d'Afrique et d'Asie, la fin magnifique de l'apartheid en Afrique du Sud : minoritaires dans les années 1970, les pays démocratiques sont désormais majoraitaires dans le monde.
Il faut dire aussi que la démocratie est sœur du développement: les progrès économiques favorisent les progrès politiques qui, en retour, accélèrent le développement. Ce n'est pas un hasard : la démocratie, c'est la décision favorable au plus grand nombre, donc des mécanismes de production et de répartition économiques et sociales qui encouragent l'enrichissement collectif donc la croissance. Il n'y a pas de développement sans liberté économique ni régulation collective. Et il n'y a pas de liberté économique durable sans liberté civile et politique, ni de régulation sans expression démocratique des besoins de la population.
2) Dans la plupart des pays développés, les démocraties ont atteint un degré d'accomplissement sans précédent.
Elles ne sont plus que très rarement menacées de l'intérieur par des forces politiques imposantes qui se réclameraient, au nom de la révolution sociale ou nationale, de leur renversement. Grâce aux progrès de l'éducation, ainsi que des libertés et des innovations technologiques, leurs citoyens ont un niveau de formation et d'information qui permet l'exercice véritable de la démocratie pluraliste et des institutions représentatives. Partout, les lois ont consolidé les piliers de la démocratie : les libertés fondamentales avec l'émergence de droits nouveaux, comme l'égalité des femmes et des hommes dans le droit de la famille, la reconnaissance progressive du droit des femmes à disposer de leur corps, le droit des enfants, l'égalité de droit des homosexuels et des hétérosexuels... ; les contre-pouvoirs avec l'établissement partout d'une Cour Constitutionnelle, la reconnaissance pleine et entière des pouvoirs du juge, y compris parfois à l'échelon supranational (Cour européenne des droits de l'homme. Cour de justice de la Communauté Européenne...), l'instauration d'autorités indépendantes de régulation (par exemple en matière boursière, de concurrence ou de communication...) ; la souveraineté du peuple avec l'extension progressive du droit de suffrage aux femmes, aux militaires, aux jeunes, à certains résidents étrangers... Partout aussi, les mœurs ont évolué profondément, modifiant dans les esprits, et non seulement dans les lois, la place faite aux femmes, aux jeunes, aux minorités sexuelles, ethniques ou religieuses. Bref, les sociétés contemporaines paraissent avoir accompli, au-delà des espérances, la prophétie
B - ET POURTANT, CETTE DÉMOCRATIE, APPAREMMENT APAISÉE,
« tocquevilienne », l'épanouissement démocratique.
que ne menacent plus les passions révolutionnaires internes ou les agressions totalitaires externes, qui s'enracine dans les progrès de l'éducation et se fortifie dans ceux de l'information, qui se fonde sur la très sûre assise d'un socle puissant de lois et de coutumes, donne des signes de fragilité.
Elle paraît minée par le désenchantement, le découragement, quand ce n 'est pas par le ressentiment. En 1995, 35 % des Français interrogés considéraient la politique comme une activité peu honorable, 65 % avaient le sentiment de n'être pas bien représentés par un parti, 65 % par un leader politique, 75 % par un syndicat. 56 % jugeaient que les élus et dirigeants politiques français étaient plutôt corrompus.
L'écart se creuse entre les gouvernants et les gouvernés. Deux phénomènes concourent principalement à expliquer et renforcer ce divorce :
1) D'abord, l'exclusion
La démocratie postule la cohésion sociale et l'inclusion de ses acteurs dans une même communauté. Or, les phénomènes de ségrégation et de rejet se multiplient. Le pays se segmente, se parcellise en groupes séparés, parfois relégués sur les bas-côtés. Cette situation d'exclusion revêt des formes multiples.
a) L'exclusion sociale
Elle est la plus grave.
On assiste à la « tiers-mondisation », voire à la « quart-mondisation » d'une fraction de la société. Que signifie alors le mot « liberté » pour celui qui a faim, celui qui a froid, celui qui n'a pas de toit ? Qu'est-ce que la citoyenneté pour des millions de salariés précaires ou pour les chômeurs qui courent entre l'ANPE et les petits boulots ?
Les faits sont là, accablants : trois millions de chômeurs ; quatre millions de salariés en contrat à durée déterminée, en intérim, à temps partiel ou en contrats aidés ; des logements en nombre insuffisant ou des logements privés des conditions d'un confort élémentaire : 13 % des ménages français vivent ainsi dans des logements précaires, disposant au mieux de l'eau courante ; des familles éclatées sous l'effet des difficultés de toute nature (11 % de familles monoparentales parmi les chômeurs, contre 6 % parmi les actifs occupés) ; des inégalités criantes et croissantes d'accès à l'éducation (26 % des personnes sans diplôme parmi les chômeurs contre 14 % parmi les actifs occupés, 2,3 millions de personnes concernées par les phénomènes d'illettrisme).
L'exclusion sociale entraîne le plus souvent une désillusion civique qui se traduit par l'indifférence à la chose publique ou par le vote protestataire.
A cette déshérence des nouvelles « classes souterraines » — comme le disent les anglo-saxons -, exclues du corps social et sans expression dans le corps politique, s'ajoutent de plus en plus les inquiétudes des couches populaires, les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires où progresse le Front national : laissés pour compte de la modernisation économique, menacés directement par le chômage, effrayés par la levée des protections nationales, premières victimes de la montée des insécurités et des incivilités, premiers témoins de la détérioration des équipements collectifs, ils se reconnaissent de moins en moins dans des institutions qui ne semblent pas les reconnaître assez, entendre leurs protestations ou faire droit à leurs revendications. Ainsi s'accroît le sentiment d'une coupure entre « ceux d'en haut » et « ceux d'en bas », le peuple et les élites.
La France se croyait composée d'une vaste classe moyenne apaisée. Elle se découvre morcelée par des lignes de clivage social et bientôt politique, auxquelles s'ajoutent des exclusions plus discrètes, mais non moins puissantes.
b) Les inégalités hommes-femmes
Les femmes ont considérablement œuvré pour dépasser les limites de la sphère familiale dans laquelle notamment la Révolution, puis le Code Civil les avaient placées, leur réservant un statut de mineures.
Elles bénéficient d'un égal accès à l'éducation, où elles réussissent d'ailleurs souvent mieux que les garçons. Elles ont fait une entrée remarquée dans le monde du salariat. Leur acharnement à revendiquer la maîtrise de leur corps leur a permis d'accéder au droit à la contraception et à l'I.VG., ainsi qu'au droit à leur remboursement.
Mais, ces progrès ne sont pas pour autant la garantie d'une égalité de fait.
Les femmes sont les plus touchées par les conséquences de la crise et subissent de plein fouet le chômage et la pauvreté. Leurs filières de formation et le nombre de métiers auxquels elles ont accès sont très peu diversifiés. Leurs emplois restent plus précaires, moins qualifiés et moins rémunérés que ceux des hommes. A compétence et diplômes égaux, elles restent plus mal payées que leurs collègues masculins. Dans le domaine privé, les femmes françaises supportent encore l'essentiel du poids de la sphère domestique. De plus, depuis quelques années, elles subissent l'assaut de ceux qui leur contestent le droit de maîtriser leur fécondité.
Mais la situation d'inégalité et d'exclusion la plus criante est celle de leur infime présence dans la vie publique. Si elles sont plus de 20 % pour ce qui concerne les mandats de conseillères municipales et de députées européennes, tous les autres mandats nationaux et locaux les cantonnent dans une représentation indigne. Les chiffres sont brutaux. Les femmes forment 53 % du corps électoral et les hommes monopolisent à 95 % la représentation parlementaire. Rares aussi sont les femmes qui participent à l'organisation des partis politiques.
A la résistance des hommes s'ajoute la réticence des femmes elles-mêmes à l'égard du pouvoir politique tel qu'il est trop souvent exercé : trop éloigné des préoccupations concrètes, déconnecté de la vie de nos concitoyens et impropre à trouver des solutions à de nombreux problèmes.
c) Les difficultés d'insertion des jeunes
Ils sont souvent rejetés du monde du travail et leurs espérances s'assombrissent à mesure que la crise s'enracine, ballottés d'échecs scolaires en C.I.P. par un monde adulte - en particulier politique -, qui paraît ne pas savoir les comprendre ni leur parler, quoi qu'il soit secoué de loin en loin à l'occasion d'un film choc - « Les Nuits Fauves » ou « La Haine » —, par un sursaut soudain de (mauvaise) conscience et de compassion.
La galère
Pour certains de ces jeunes, malheureusement, l'absence totale de perspective peut conduire à la délinquance et à la drogue, c'est-à-dire à la solitude et à la confrontation avec l'arsenal répressif, première étape d'un cercle vicieux qui s'entretient lui-même : le traitement policier du malaise d'une fraction de la jeunesse peut entraîner une sécession individuelle plus grande encore et porter à la violence, laquelle provoque en retour la répression. Pour certains jeunes, le policier et le gardien de prison sont finalement le visage d'un monde adulte décidément inhospitalier et vieillissant !
Certes la « galère » n'est pas le lot de tous les jeunes. Beaucoup ont accès aux formations et finissent par s'insérer dans le monde professionnel. Mais leur vie personnelle ou collective s'inscrit rarement dans un mouvement, une espérance, un projet fût-il utopique, — qui permettrait un dépassement de soi, une ouverture à l'autre.
La mort des sociétés qui cessent de rêver
L'exclusion des jeunes, c'est cela : le sentiment d'un univers fini, d'une société sans perspective, repliée sur elle-même, sans idéal possible, sans vision universaliste. A cette clôture de l'horizon, cette stérilisation des espérances et des rêves — et peut-être les sociétés sont-elles comme les hommes : quand on les empêche de rêver, elles meurent —, s'ajoute un « style » politique qui les éloigne des adultes. On parle aux jeunes comme à un groupe d'intérêt, une clientèle, un quelconque lobby. A leur quête secrète de sens, d'aventure collective, de transgression des égos, on répond par des sondages ou par un catalogue de mesurettes techniques. Ils parlent, sans nécessairement prononcer les mots de tendresse et de fraternité, d'aspiration et d'idéal. Et nous ne savons pas les entendre. Comment s'étonner alors que même ceux qui ne connaissent pas le triste destin de la marginalité ne se sentent pas tout à fait à leur place dans ce monde ? Or, une société cruelle avec sa jeunesse est une société sans futur.
d) La marginalisation des anciens
Est-ce à dire que notre société serait plus apte à inclure les plus anciens dans la vie sociale ? Tel n'est malheureusement pas le cas. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, quittent la vie active dans la pleine force de l'âge, riches d'une expérience professionnelle, et d'un capital de souvenirs et d'idées. Au lieu de faire appel à cette énergie qui ne demanderait souvent qu'à s'investir dans des missions civiques, notre système les relègue dans l'inactivité.
e) L'exclusion des personnes handicapées
Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de personnes, à la suite d'un accident domestique, de la route, du travail, ou tout simplement à la naissance, en relation avec les progrès de la science qui sauvent de nombreuses vies humaines, restent handicapées à vie.
Aux déficiences physiques ou mentales de ces personnes, viennent s'ajouter un environnement hostile parce que trop souvent inaccessible, une tendance au rejet de celui qui ne serait pas dans la « norme » ; trois à cinq millions de nos concitoyens sont concernés. Le handicap est donc un fait de société.
Le handicap n'étant ni conjoncturel, ni marginal, il appelle à une prise de conscience générale et à une politique globale de citoyenneté et de dignité. A une vision libérale et charitable distillant assistance et ségrégation, il faut opposer une conception humaniste et citoyenne, basée sur l'accès à l'autonomie et l'intégration.
L'exclusion sous toutes ses formes dissout le sentiment d'appartenance à la communauté nationale ou locale. Une démocratie vivante a besoin pour s'épanouir que se tissent ou se retissent entre ses membres des liens sociaux, civiques et humains. Alors chacun peut se sentir réellement co-auteur ou co-responsable de changements dont il sera collectivement ou individuellement le bénéficiaire.
2) A ce sentiment d'exclusion, aussi divers et complexe que les inégalités elles-mêmes, s'ajoute un sentiment d'impuissance
a) Et d'abord l'impuissance des gouvernants sur les choses
Le pouvoir politique s'est laissé trop souvent déposséder au bénéfice d'autres pouvoirs.
Le discours de la contrainte paraît avoir partout remplacé celui du projet ou de l'ambition.
— contrainte « extérieure » des marchés internationaux, dont les évolutions erratiques paraissent infiniment plus déterminantes pour la santé économique et sociale des nations que les décisions des gouvernements ou des parlements ;
— contrainte « extérieure » des institutions internationales ou régionales, comme l'Union Européenne, édifiée pourtant par la volonté des Etats, mais qu'ils n'ont pas dotée d'instances de contrôle démocratique suffisante pour que les citoyens s'y reconnaissent, et derrière lesquelles les gouvernements s'abritent souvent pour justifier des mesures impopulaires tout en s'attribuant à eux seuls les bienfaits qui peuvent en résulter ;
— contrainte « extérieure » des mouvements transfrontières que les autorités nationales ne savent arrêter, qu'il s'agisse des capitaux, des virus, des nuages radioactifs ou des stupéfiants ;
— contrainte des médias enfin : les autorités publiques sont également concurrencées ou contestées par « l'Opinion », cette nouvelle déesse dont les médias et les instituts de sondage sont le clergé ou l'oracle. Absolument nécessaire à la démocratie de représentation, parce qu'elle assure l'expression du peuple entre deux consultations électorales, la démocratie d'opinion n'en émousse pas moins le crédit et la faculté d'action des dirigeants publics. Privilégiant le choc des photos par rapport au poids des mots, l'instant présent par rapport au temps long et à l'anticipation, la décision à chaud par rapport à la délibération à froid, la passion par rapport à la raison, simplifiant les enjeux et accélérant la décision politique, la « médiacratie » déstabilise, pour le meilleur et pour le pire, l'action publique, et accroît, chez les citoyens, le sentiment d'une impuissance des dirigeants devant l'événement.
Etrange paradoxe, cet Etat qui se voulait fort montre chaque jour sa faiblesse se face à ceux qui détiennent le pouvoir économique, médiatique ou technique.
Enfin, certaines de ces autorités voient leur crédibilité sapée de leur propre fait. A force, comme Jacques Chirac, de faire des promesses aussitôt oubliées après l'élection, de dire qu'on mènera une politique et d'en conduire finalement une autre, bref, à force de démagogie, on érode la confiance que les citoyens peuvent avoir dans leurs représentants, et dans la capacité de ceux-ci à changer les choses.
// s 'y ajoute le sentiment de l'irresponsabilité et de l'impunité. D'un côté, des «responsables publics » peuvent impunément par leurs fautes de gestion jeter des milliards par les fenêtres - loin d'être sanctionnés, ils se trouvent parfois promus à des fonctions plus élevées-, de l'autre, pour combler les trous occasionnés par cette impéritie, on matraque les pauvres et les classes moyennes par de nouveaux prélèvements sociaux et fiscaux.
Le spectacle est souvent offert de dirigeants qui empilent des décisions contradictoires, manipulent le système fiscal comme on joue au yoyo, tirent des chèques sans provision sur les finances de l'Etat, sans être vraiment capables à aucun moment d'offrir une vision claire, lisible de leur action, encore moins de proposer à la société un idéal mobilisateur.
Bref, en raison de cette impotence des hauts responsables, la France paraît malade d'avenir.
b) Mais ce sentiment d'impuissance est également celui des citoyens à qui le pouvoir sur les gouvernants paraît de plus en plus échapper
Constaté dans toutes les démocraties, ce sentiment est particulièrement vrai en France : notre tradition de concentration des pouvoirs, malheureuse exception française, aggrave la coupure entre représentés et représentants. Les décisions sont l'apanage de quelques-uns qui, loin du peuple et en coulisses, prétendent régenter seuls la société.
Trois phénomènes y contribuent :
- La concentration sociologique des élites tout d'abord, qui sont formées au même moule des Grandes Ecoles : équitablement réparties entre le pouvoir administratif, politique et économique, au gré des carrières qui permettent souvent de passer de l'un à l'autre de ces secteurs ; géographiquement installées, le plus souvent dans la capitale ; entretenant des complicités, dans le « micro-milieu » du « tout Paris », avec la presse, la radio et la télévision. Cette « super élite », comme l'écrivait un hebdomadaire, n'incarne peut-être pas une «pensée unique », mais très certainement un langage unique de la pensée, une manière commune de raisonner et de s'exprimer, fût-ce pour exposer des points de vue opposés.
Aussi donne-t-elle aux citoyens l'impression qu'il existe deux mondes, communiquant mal entre eux. Le monde des dirigeants - d'entreprises, de médias, de partis...- serait un monde fermé, auto-protégé par ses immunités juridiques ou ses relations d'influence, qui n'entendrait pas le monde des citoyens ordinaires, ne le représenterait pas.
- Ce phénomène est favorisé par une hypertrophie des exécutifs.
Le super-présidentialisme à la française qui a fait entrer en 1958 le bonapartisme dans la République, donne, de fait ou de droit, au Président de la République, et pendant sept ans renouvelables, le pouvoir de nommer et de démissionner les gouvernements, de nommer aux emplois principaux de l'Etat, de faire les lois lorsqu'il dispose d'une majorité, de dissoudre l'Assemblée, d'introduire un référendum... Il a anémié le Parlement et, par conséquent, affaibli, à travers leurs représentants, la capacité des citoyens à peser sur les choix.
Cette « culture de l'exécutif» tend à imprégner toutes les institutions locales, à l'échelle municipale, départementale, régionale.
Elle se retrouve également au sein des entreprises où, depuis les lois de Vichy ayant créé le Président-Directeur Général, et contrairement au droit des autres pays européens, le patron exerce seul les responsabilités sous le contrôle à éclipse et sans grand moyen d'un Conseil d'administration.
- A la concentration des élites, à l'hypertrophie des exécutifs s'ajoute la faiblesse historique des autres pouvoirs et des corps intermédiaires :
• les assemblées délibérantes : elles sont, à tous les échelons du pouvoir, affaiblies par rapport à leur exécutif. A l'étouffement du Parlement, répond la faiblesse des assemblées locales dont l'ordre du jour, le déroulement des séances, les modalités de vote sont laissés à la discrétion de l'exécutif;
• le juge : s'il a acquis depuis une dizaine d'années une véritable indépendance de fait, encore cette indépendance ne se traduit-elle pas dans le droit : notamment les liens du Parquet avec le pouvoir politique, et les règles de carrière des magistrats, continuent de placer la justice dans une dépendance ;
• quant aux corps intermédiaires, ils sont à la portion congrue : les syndicats organisent 9 % des salariés, à peine 1 % des 18-24 ans; les partis peinent à organiser, en dehors des campagnes électorales, la mobilisation et la participation au débat public de leurs militants, en nombre insuffisant ; les associations, premier lieu de la démocratie de proximité, peuvent difficilement se constituer en représentants des citoyens pour une participation à l'exercice du pouvoir.
La conjonction de ces facteurs aboutit à vider partiellement la citoyenneté de sa substance, à raréfier les espaces de délibération, à cadenasser les procédures de négociation et de dialogue, et à encourager l'érosion du lien civique et le repliement sur soi.
II - UNE ESPÉRANCE TOUJOURS VIVANTE
Qu'on ne se méprenne pas cependant. Pour être sévère, ce constat ne vaut pas pronostic définitivement pessimiste sur l'évolution de la société et de la démocratie françaises.
D'abord parce que nombre de ces signaux peuvent être interprétés tout autant comme indices de guérison que comme symptômes de maladie. La corruption, par exemple, est mieux connue aujourd'hui, elle est davantage poursuivie par les juges et elle est infiniment moins tolérée par les citoyens : bref, la presse est plus libre, la justice plus indépendante et les citoyens plus concernés -autant de signes de la vitalité démocratique.
En second lieu, la société française bouillonne d'initiatives, d'engagements, d'impatiences. La forte participation des citoyens aux consultations électorales, l'écho rencontré par certains débats comme celui qui eut lieu sur Maastricht, le désir toujours vivant d'agir dont l'efflorescence du monde associatif témoigne, la capacité intacte d'indignation et de mobilisation qu'a démontrée le mouvement de décembre — « Le peuple n 'est pas devenu aphone, ce sont ses représentants qui sont sourds » —, voilà de quoi se convaincre que le changement est là, en puissance, et qu'il ne demande qu'à s'accomplir pour autant qu'on trace une perspective, qu'on propose un chemin. Par sa créativité intellectuelle, politique et économique, la société est souvent en avance sur ses gouvernants.
Une nouvelle chance d'épanouissement de la démocratie surgit avec l'extension du temps libre consécutive à la réduction du temps de travail et à l'allongement de l'espérance de vie. Ce temps libéré pourrait être non pas un temps vide, mais un temps riche, un temps dense. En particulier, chacun pourra s'il le souhaite mettre au profit de la communauté nationale ou locale ses expériences personnelles, ses capacités de dévouement, son sens de l'initiative, son esprit critique et inventif.
L'enjeu des années qui viennent n 'est donc pas de réconcilier les Français avec leurs institutions démocratiques comme on le dit trop souvent. C'est, au contraire, de rapprocher ces institutions des Français. On ne peut garder tels quels ces mécanismes nés d'une époque où l'Etat tuteur préservait les citoyens jugés infantiles contre eux-mêmes, au nom d'un intérêt général dont il détenait la vérité. Il faut faire franchir à la démocratie française, à bien des égards immature, une étape nouvelle. Il faut rompre avec cette tradition française de méfiance à l'égard des libertés des citoyens, des corps intermédiaires et des contre-pouvoirs. Trop de démocratie ne nuit pas à la démocratie. Les citoyens mûrs, formés, informés, ont droit à des institutions dans lesquelles ils puissent se retrouver pleinement.
Il faut donc s'attaquer avec détermination à ce mal ancien et chronique : les détenteurs des pouvoirs politiques et économiques se comportent encore trop volontiers comme s'ils étaient les propriétaires de leur fonction oubliant qu'ils tiennent leur responsabilité du peuple souverain et qu'ils doivent en retour lui assure attention et protection.
De cette conception des pouvoirs résultent deux conséquences :
- au lieu d'être l'affaire de tous, le pouvoir tend à être l'affaire particulière de quelques-uns ;
- loin d'être effectivement garantis, les droits individuels et les libertés paraissent avoir été provisoirement concédés, consentis et être le fruit non pas d'une obligation absolue des pouvoirs vis-à-vis des citoyens, mais d'une bonne volonté éventuellement révocable.
Du même coup, l'Article 16 de la Déclaration de 1789 garde toute sa fraîcheur : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n 'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n 'a point de constitution ». Tout y est dit sur les deux exigences impérieuses à ce jour non satisfaites qui déterminent le caractère démocratique d'une société :
Notre volonté est de redonner une respiration nouvelle à la démocratie française en restituant aux citoyens leurs droits et leurs pouvoirs. Pas seulement en paroles, mais en actes concrets.
Première partie:
Les pouvoirs des citoyens: de la décision confisquée à la décision partagée
Deuxième partie:
Les droits des citoyens : des principes proclamés aux droits effectifs