

![[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]](/images/digbib/d_digbib.gif)
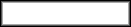
Version français:
Charles Valy Tuho:
L'Afrique de l'ouest et l'avenir des relations entre les pays ACP et l'Union européenne
- 2.1 Les principales caractéristiques économiques et sociales
- 2.2 Les potentialités de l’UEMOA
- 2.3 Les difficultés de la CEDEAO
- 3.1 Les programmes indicatifs régionaux en Afrique de l’Ouest
- 3.2 L’ajustement structurel
- 3.3 Le secteur privé et autres acteurs
- A/ Les intérêts communs
- B/ La future coopération
- 4.1 L’Afrique de l’Ouest et les Futurs de la Convention de Lomé
- 4.2 Les secteurs stratégiques de coopération
[Titre]
[Résumé]
Remerciements
Table des matières
Abréviations
2. Les contraintes et les potentialités du développement de la région
3. Expériences des relations avec l’union européenne
4. Vers de nouvelles relations Afrique de l’ouest-UE
[page-number of print-ed.(French part): 1 = Title]
Arbeitspapiere zur EU-Entwicklungspolitik
Working papers on EU-Development Policy
Documents de travail sur la politique du développement de l’UE
3
Charles Valy Tuho
L’Afrique de l’Ouest et l’avenir des relations entre les pays ACP et l’Union européenne
[page-number of print-ed.(French part): 2]
Arbeitspapiere zur EU-Entwicklungspolitik
La série „Documents de travail sur la politique du développement de l’UE" traite des questions actuelles de la politique européenne du développement. Elle doit proposer un forum pour discuter d’options politiques concernant la configuration de la politique européenne du développement et le dialogue Nord-Sud. Son objectif est de contribuer à une plus grande transparence sur la voie d’une politique européenne du développement coordonnée et cohérente, conformément au Traité de Maastricht.
ISSN …1432-9824
ISBN …3-86077-595-2
La série paraît de manière irrégulière. Elle peut être commandée gratuitement auprès de la fondation: Friedrich-Ebert-Stiftung, D-53170 Bonn/Allemagne.
Editeur: |
Projektgruppe Entwicklungspolitik
|
Copyright 1996 by Friedrich-Ebert-Stiftung
Godesberger Allee 149, 53175 Bonn
Layout: PAPYRUS – Schreib- und Büroservice
Printed in Germany 1996
[page-number of print-ed.(French part): 3]
Charles Valy Tuho
L’Afrique de l’Ouest et l’avenir des relations
entre les pays ACP et l’Union européenne
Une analyse des limitations du potentiel de développement régional montre que toute une série de facteurs sociaux, économiques et institutionnels ont entravé l’évolution de l’intégration régionale. Il faut encore élaborer une approche plus pragmatique de l’intégration régionale. Dans ce contexte, l’expérience de la coopération avec l’UE montre que Lomé a eu une incidence sur différents domaines au niveau régional grâce aux programmes indicatifs régionaux. Le soutien accordé à l’ajustement structurel a été développé selon une logique nationale et n’a pas favorisé l’intégration régionale. Une première conclusion est que les effets de la coopération européenne sur le processus d’intégration régionale ont été assez négatifs. On attend désormais du secteur privé régional qu’il participe davantage au processus d’intégration régionale. Néanmoins, une coopération renouvelée avec l’UE sera indispensable à l’avenir. Elle se fondera sur tout un éventail d’intérêts communs tant économiques que sociaux. Afin d’accroître son impact sur l’intégration régionale, l’UE devra concentrer son soutien sur des secteurs stratégiques allant du développement des infrastructures à la promotion du secteur privé et à la promotion de la démocratie. Cette coopération renouvelée nécessitera de nouvelles institutions qui restent encore à déterminer.
[page-number of print-ed.(French part): 4]
Remerciements
Ce document a été élaboré en vue du séminaire organisé sur le thème „L’avenir de Lomé" par la Friedrich-Ebert-Stiftung à Bruxelles les 10 et 11 juin 1996 et de la conférence intitulée „L’avenir des relations ACP-UE au-delà de Lomé IV", tenue du 12 au 14 juin 1996 à Maastricht, à l’initiative du Centre européen de gestion des politiques de développement (ECDPM).
Nous tenons à remercier l’ECDPM du soutien qu’il nous a apporté pendant la phase de préparation de ces études; la coopération régulière et constructive qu’il nous offre pour traiter de nombreuses questions relatives au développement nous est précieuse.
Nous aimerions également exprimer notre sincère reconnaissance à tous ceux qui ont contribué au processus de publication de ces études. Leur aide et leurs effort ont permis la réussite du projet.
[page-number of print-ed.(French part): 5]
1. |
INTRODUCTION |
7 |
||
2. |
LES CONTRAINTES ET LES POTENTIALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION |
8 |
||
2.1 |
Les principales caractéristiques économiques et sociales |
8 |
||
a) |
Les caractéristiques démographiques et sociales |
8 |
||
b) |
Les contraintes économiques et institutionnelles |
9 |
||
2.2 |
Les potentialités de l’UEMOA |
9 |
||
2.3 |
Les difficultés de la CEDEAO |
10 |
||
3. |
EXPÉRIENCES DES RELATIONS AVEC L’UNION EUROPÉENNE |
12 |
||
3.1 |
Les programmes indicatifs régionaux en Afrique de l’Ouest |
12 |
||
3.2 |
L’ajustement structurel |
13 |
||
3.3 |
Le secteur privé et autres acteurs |
13 |
||
4. |
VERS DE NOUVELLES RELATIONS AFRIQUE DE L’OUEST-UE |
15 |
||
A/ |
Les intérêts communs |
15 |
||
B/ |
La future coopération |
15 |
||
4.1 |
L’Afrique de l’Ouest et les Futurs de la Convention de Lomé |
16 |
||
4.2 |
Les secteurs stratégiques de coopération |
16 |
||
5. |
CONCLUSION: LES INSTITUTIONS DE LA COOPÉRATION RÉNOVÉE |
18 |
||
AU SUJET DE L’AUTEUR |
19 | |||
[page-number of print-ed.(French part): 6]
Abréviations
ACP |
Afrique, Caraïbes et Pacifique |
BAD |
Banque africaine de développement |
CCAO |
Chambre de compensation de l’Afrique de l’Ouest |
CDF |
Fonds de développement communautaire |
CEDEA |
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest |
CEE |
Communauté économique européenne |
CFAO |
Compagnie française de l’Afrique occidentale |
CIRES |
Centre ivoirien de recherches économiques et sociales |
FED |
Fonds européen de développement |
FOSIDE |
Fonds de solidarité et d’intervention pour le développement de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest |
OMC |
Organisation mondiale du commerce |
OMVS |
Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal |
PIR |
Programme indicatif régional |
SCOA |
Société commerciale de l’Ouest Afrique |
UEMOA |
Union économique et monétaire de l’Ouest africain |
[page-number of print-ed.(French part): 7]
1. Introduction
L’origine des relations entre l’Afrique Occidentale et l’Europe remonte à une époque lointaine. On sait qu’à partir du 15e siècle, commença la traite négrière qui prit fin au 18e siècle, et, au 19e siècle la conférence de Berlin procéda au partage de l’Afrique et à l’installation territoriale des puissances européennes en Afrique.
En Afrique de l’Ouest, la France regroupa ses territoires en une fédération: l’Afrique occidentale française (AOF) comprenant les 9 pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte-d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et plus tard le Togo. Pour la Grande Bretagne: la Gambie, le Ghana, le Nigeria et la Sierra Leone. Pour le Portugal, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, tandis que le Libéria restait indépendant.
L’indépendance politique acquise par la plupart de ces pays en 1960 devait entraîner une évolution dans les relations entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe. De fait, la création de la CEE en 1957 avait permis l’institution du Fonds Européen de Développement (FED) au profit des anciennes colonies. Ce Fonds fut intégré aux Conventions de Yaoundé dont la première date de 1963. Mais l’élargissement de la CEE devait permettre le regroupement des anciennes colonies des puissances européennes et quelques autres pays africains avec des pays des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et la signature de la première Convention de Lomé en 1975.
Celle-ci fut suivie de trois autres Conventions de Lomé, toutes de durée quinquennale à l’exception de Lomé IV dont la durée est d’une dizaine d’années, l’échéance étant, comme on le sait, l’an 2000.
Dans le cadre de cette réflexion prospective sur l’Après-Lomé IV, l’accent sera mis sur la coopération régionale, l’une des priorités des Conventions de Lomé et trois questions se posent en ce qui concerne l’Afrique de l’Ouest:
- Quelles sont les contraintes actuelles et les potentialités du développement de la région?
- Quelles sont les leçons de l’expérience des relations de l’Afrique de l’Ouest avec l’Union Européenne?
- Enfin, les perspectives d’une coopération renovée dans le cadre de ces relations.
[page-number of print-ed.(French part): 8]
2. Les contraintes et les potentialités du développement de la région
L’Afrique de l’Ouest connaît une certaine diversité des zones climatiques et des reliefs avec une richesse du sous-sol en minéraux et hydrocarbures et l’importance du peuplement, estimé à environ 194 millions d’habitants en 1990 pour l’ensemble des seize pays de la région.
Les potentialités économiques ouest-africaines sont importantes. Mais compte tenu de l’optique envisagée, celles des relations entre l’Afrique de l’Ouest et l’UE, il nous faut insister sur les problèmes de la coopération et de l’intégration régionale, après avoir évoqué les principales caractéristiques économiques et sociales de la région. on évoquera donc:
- Les principales caractéristiques économiques et sociales
- Les potentialités de l’UEMOA
- Les difficultés de la CEDEAO
2.1 Les principales caractéristiques économiques et sociales
Pour les observateurs, l’une des principales caractéristiques en Afrique de l’Ouest est que „l’espace est un continuum à l’intérieur duquel les découpages sont arbitraires. Les frontières nationales définissent des territoires. Ceux-ci sont débordés d’en bas par l’appartenance à des réseaux transfrontières. Ils sont également débordés d’en haut par les appartenances multiples à des ensembles qui se chevauchent. Il n’y a pas ainsi de correspondance entre l’espace national défini par les frontières territoriales et les espaces de déploiement des stratégies des opérateurs". [Selon J. Coussy et Ph Hugon: „Intégration régionale et ajustement structurel en Afrique Sub-Saharienne" Ministère de la Coopération Paris 1991 P. 48.]
C’est dans ce contexte qu’on exposera d’abord les caractéristiques démographiques et sociales, ensuite les contraintes économiques et institutionnelles.
a) Les caractéristiques démographiques et sociales
Selon l’étude perspective à long terme de l’Afrique de l’Ouest (1994) [Le club du Sahel et cinergie 1994.] les dynamiques de peuplement expliquent en grande partie l’évolution passée de l’Afrique de l’Ouest et détermineront son avenir au moins à l’échelle d’une génération.
La population de l’Afrique de l’Ouest, y compris le Cameroun et le Tchad, est passée de 45 millions de personnes en 1930 à 87 millions en 1960 et 194 millions en 1990. Elle atteindra probablement 430 millions d’habitants en 2020. Cette hypothèse moyenne, retenue par l’étude, se situe en bas de la fourchette des projections généralement admises et tient compte de l’impact de la pandémie du Sida.
La proportion d’urbains au sein de cette population est passée de 4% En 1930 à 14% en 1960 et 40% en 1990. Elle dépassera 60% en 2020. En dépit de la croissance des villes, la population rurale a augmenté de 60% entre 1960 et 1990 et continuera de croître pendant encore au moins deux décennies. En l’espace de quatre générations, la région aura donc vu sa population totale multipliée par 10 et sa population urbaine par 100. Ce phénomène est d’une telle ampleur qu’il devient déterminant dans l’évolution des économies et des sociétés ouest-africaines et dans la géopolitique régionale.
Le nombre d’urbains est passé de 12 millions à 78 millions entre 1960 et 1990, les villes absor-
[page-number of print-ed.(French part): 9]
bant près des deux-tiers de la croissance démographique totale.
Quant à la caractéristique sociale, elle peut être résumée par le fait que, comme pour toute l’Afrique, l’on prend de plus en plus conscience d’un fait capital: la perte de sa capacité à maîtriser les conditions mêmes de l’existence humaine et à fonctionner comme puissance de créativité spirituelle et culturelle. D’où une crise sociale qui se traduit par l’aspect d’un monde apathique, sans souffle apparent et entièrement soumis aux aléas des interventions extérieures: chocs économiques, politiques, sociaux et culturels.
b) Les contraintes économiques et institutionnelles
L’Afrique de l’Ouest comme espace économique commun est caractérisé par la situation suivante:
- L’importance des facteurs historiques d’intégration, en particulier entre pays enclavés et pays côtiers. Ces circuits persistent sous la forme d’échanges informels malgré les obstacles formels aux échanges mis en place par les Etats. Cette évolution historique a entraîné l’apparition de sous-espaces d’échanges à l’intérieur de la région. En effet le club du Sahel et le CILSS ont identifié trois sous-espaces principaux en Afrique de l’Ouest [CF processus régionaux d’intégration en Afrique de l’Ouest: repprochements institutionnels ou espaces spontanés textes. E. Crenon et A. Vuillet. Université Laval 1994 P. 37.]:
- Sous-espace ouest: Sénégal, Gambie, Mauritanie, Mali-Ouest;
- Sous-espace centre: Mali Est, Burkina Faso, Côte-d’Ivoire, Ghana;
- Sous-espace est: Nigeria et ses voisins, en particulier le Bénin le Togo et le Niger.
Les autres caractéristiques de l’espace économique ouest-africain sont bien connus à savoir:
- les grandes inégalités de développement économique, en particulier entre pays enclavés et pays côtiers et aussi entre le Nigéria et les autres pays de la région.
- l’étroitesse des marchés nationaux à l’exception du Nigeria, mais aussi l’importance des liens commerciaux entre ces états et les pays du Nord, l’Europe notamment, par rapport aux liens intrarégionaux qui demeurent assez faibles.
- le manque de spécialisation: il y a souvent la multiplication des mêmes investissements (textiles, sucreries, huileries, cimenterie) et par conséquent, la production se fait sur une petite échelle.
Du point de vue institutionnel, il y a une multitude d’organisations à vocation régionale. Mais les plus importantes sont les organisations de mise en valeur des fleuves, Sénégal (OMVS), Gambie et Mano.
A ce regroupement autour des fleuves, fait pendant le regroupement autour du Sahel, le comité inter-Etat de lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS).
Les organisations supra-nationales sont principalement au nombre de deux qui mettent en lumière les potentialités de l’intégration et de la coopération régionale en Afrique de l’Ouest. Ce sont: la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) devenue avec quelques modifications Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) et la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Mais si la CEDEAO connaît des blocages, ces difficultés sont moindres pour l’UEMOA.
2.2 Les potentialités de l’UEMOA
A l’origine la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) est un héritage colonial. Créée en 1966, elle essaie de ressouder la plupart des anciens territoires de l’ex-Afrique occidentale Française (AOF) avec le Bénin le Burkina, la Côte-d’Ivoire, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal.
Ces Etats ont pour objectif de favoriser „une croissance plus rapide et mieux équilibrée" et les instruments de la coopération régionale repose sur trois principaux mécanismes:
- La TCR (Taxe de Coopération Régionale). C’est un tarif préférentiel qui concerne les
[page-number of print-ed.(French part): 10]
- Le FCD ou Fonds Communautaire de Développement. Il a pour objet de répartir les fruits de l’intégration et a une fonction de compensation financière et commerciale entre pays exportateur et pays importateur.
- Le FOSIDEC, qui est un fonds de solidarité, a été créé en 1978; il a vu ses dotations passer de 5 milliards CFA en 1979 à 13,5 Milliards en 1984. Il a permis la mobilisation de 37,4 milliards d’emprunts et est intervenu pour 26,3 milliards.
- La CEAO a intensifié les échanges intra-communautaires qui sont passés de 5,1% en 1965 à 6,2% en 1980 et à 7% en 1985. Mais elle a connu une crise: les difficultés financières ont accru les disfonctionnements et empêché le financement des mécanismes de compensation. Le régime de la TCR a été remplacé par un prélèvement communautaire de solidarité.
produits agréés. Trois produits sont différenciés: les produits du cru et de l’artisanat traditionnel qui sont dégrevés de droit de douane; les produits industriels agréés à la TCR et les produits non agréés.
A partir de 1994, la CEAO a été remplacée par l’Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain (UEMOA) ne comportant plus la Mauritanie, mais en plus le Togo et le Mali. Elle intègre en outre l’aspect monétaire (UMOA).
2.3 Les difficultés de la CEDEAO
Créée en 1975, la CEDEAO regroupe 16 états. Mais il existe de grands écarts de développement entre ces pays. Aussi a-t-on distingué trois groupes en ce qui concerne l’application et l’échéance du désarmement douanier. Le premier groupe est celui des pays les plus riches et les plus industrialisés comprenant le Nigeria, la Côte-d’Ivoire, le Ghana et le Sénégal. Le second était composé des 12 autres états. Mais par la suite a été identifié un groupe intermédiaire comprenant la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Liberia, le Togo et le Bénin.
Selon le traité instituant la CEDEAO, „ le but de la communauté est de promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l’activité économique avec pour objectifs d’élever le niveau de vie de ses peuples, d’accroître et de maintenir la stabilité économique, de renforcer les relations entre ses membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain " (art. 2).
L’objectif est donc très ambitieux. Cependant le traité n’impose pas l’union monétaire aux états membres, mais il a prévu l’harmonisation des politiques monétaires nécessaires au bon fonctionnement de la communauté, et une chambre de compensation de l’Afrique de l’Ouest (CCAO) a été créée en 1975 par les banques centrales des Etats de la CEDEAO. De même a été prévu un fonds de coopération, de compensation et de développement, outil devant servir à améliorer la répartition équitable des coûts et des avantages de l’intégration entre les différents états membres de la communauté.
Cependant les nombreux rapports et études concernant la CEDEAO constatent tous l’inefficacité de cette organisation. Ainsi „n’ayant pas de ressources politiques et seulement quelques ressources financières limitées, l’aspiration à tout faire signifie qu’on ne parvient à rien faire" (1990).
[Selon M. Diouf: „Evaluation of West African experiments in Economic Intégration" in „The long-term perspective study of Sub-sharian Africa". Vol 4 Proceedings of a workshop on régional intégration and Cooperation. World Bank 1990.]
De son côté la Banque Africaine de Développement (BAD) dans son rapport sur les problèmes de l’intégration en Afrique (1989) observe: „Hormis la mise en place de l’appareil de coopération, les réalisations de la CEDEAO ont été plutôt maigres. Les échanges à l’intérieur de la communauté n’ont pas été stimulés mais ont plutôt eu tendance à décroître en importance".
[BAD „Rapport sur le Développement en Afrique, 1989" P. 86.]
Les obstacles à de plus grands progrès de la coopération et à l’intégration régionales au sein de la CEDEAO sont bien connus: difficultés d’ordre économique, tels que les obstacles à l’intensification des échanges [CF Allech M’BET et Camara Aïssata: groupements écono miques et commerce intra-africain. Une analyse des obstacles à l’intensification des échanges de produits manufacturés en Afrique de l’Ouest. Cah. CIRES n ° 1 Abidjan 1993.] et les problèmes d’ordre
[page-number of print-ed.(French part): 11]
monétaire. [CF O. OJO: „Obstacles monétaires et autres problèmes financiers au commerce intra-africain: étude de cas de la CEDEAO" BAD 1987.] Quant aux obstacles politiques ils sont très importants s’agissant de la faiblesse sinon du manque de volonté politique des états membres, mais aussi d’une certaine crainte vis-à-vis du Nigeria, non seulement en raison de sa puissance économique, mais aussi du fait d’une certaine approche culturelle et psychologique. Un humoriste nigérian n’a-t-il pas indiqué toute la difficulté d’être nigérian dans „How to be a nigerian"?
Cependant si l’on veut que l’intégration contribue substantiellement au développement de l’Afrique de l’Ouest, il serait sans doute nécessaire de passer de l’optique de l’intégration globale à celle d’une approche plus pragmatique dont le premier objectif serait de susciter une plus grande motivation des états membres à faire de la CEDEAO un succès et à procéder à des études pour anticiper les zones de conflit virtuel entre l’économie de chaque pays et les règles de la CEDEAO.
Enfin à l’actif de la CEDEAO il faut inscrire la création de la Banque Ecobank et surtout celle de la force communautaire de défense Ecomog.
Ainsi les contraintes du développement en Afrique de l’Ouest tiennent principalement aux problèmes économiques et sociaux et aux difficultés de la coopération et de l’intégration régionales. La porosité des frontières et de multiples réseaux de commerce font de „l’Afrique de l’Ouest une zone de libre-échange de fait".
Du point de vue des organisations régionales, selon la Banque Mondiale (1989) la CEAO (L’UEMOA) est l’union qui a le mieux réussi; elle s’est caractérisée par une convertibilité des monnaies, la mobilité du travail et du capital, et une part non négligeable du commerce intra-communautaire (supérieure à 10%). [In „L’Afrique subsaharienne de la crise à une croissance durable" 1989 P. 179.]
[page-number of print-ed.(French part): 12]
3. Expériences des relations avec l’union européenne
En Afrique de l’Ouest, aux relations traditionnelles entre les anciennes puissances coloniales et chacun des états membres de la CEDEAO, se superposent à présent celles entre l’UE et l’Afrique de l’Ouest. Ces relations sont diverses et variées, résultant de la mise en oeuvre de la Convention de Lomé, donc des échanges commerciaux et de la coopération dans les divers domaines de l’activité économique: agriculture, industrie et services.
La diversité de ces relations est donc évidente: on pourrait en évoquer l’aspect politique avec l’application des sanctions à certains états de l’Afrique de l’Ouest qui ne respecteraient pas les droits de l’homme. Il en est de même pour l’aide humanitaire pour les victimes des conflits locaux comme ceux du Liberia et de Sierra Léone.
Cependant dans l’optique qui est celle de ce rapport, à savoir le renforcement des liens d’intégration et de coopération régionales en Afrique de l’Ouest dans ses relations avec l’UE, l’aspect à privilégier au sein de ces relations est celui des financements qu’assure l’UE dans le cadre des programmes indicatifs régionaux (PIR) en Afrique de l’Ouest ainsi que l’impact des politiques d’ajustement structurel sur ce processus et le rôle du secteur privé.
3.1 Les programmes indicatifs régionaux en Afrique de l’Ouest
La coopération et l’intégration régionales sont l’un des principaux objectifs affichés de la Convention de Lomé. Depuis Lomé I, des financements sont consacrés à ce secteur de la coopération ACP-UE. Dans le cadre de Lomé IV 125 milliards d’écus sont repartis pour cinq ans entre les 7 sous-régions ACP.
Dans ce contexte, une analyse pertinente des relations entre l’Afrique de l’Ouest et l’UE, nécessiterait une recherche plus poussée relative au montant des financements assurés par le programme indicatif régional (PIR), les secteurs d’activités concernés, les délais de financements, et les résultats. Malheureusement pour le moment l’on ne peut que se contenter de quelques indications générales, l’évaluation critique de ces financements ne pourra se faire qu’ultérieurement.
Pour l’Afrique de l’Ouest le montant des financements du PIR a connu une croissance régulière de Lomé 1 à Lomé 3, pour diminuer avec Lomé IV. En effet de 94, 9 Mecu (Lomé I) ce montant a été accru sous Lomé II, (141 Mecu) et surtout sous Lomé III (242, 068 Mecu). Avec le premier protocole financier de Lomé IV, ce montant est de 228 Mecu.
Les principaux secteurs d’activité pour Lomé III et IV concernent: les transports et communications, la protection des ressources naturelles et l’environnement, la valorisation des ressources humaines (à savoir la santé, humaine et animale, la formation, la recherche agricole, la sécurité alimentaire, la coopération culturelle, la pêche) et l’intégration régionale sous la forme d’appui à l’UEMOA, à la CEDEAO et à la Coalition Mondiale pour l’Afrique.
Il est à noter qu’aucun montant n’est réservé préalablement aux organisations supra-nationales d’intégration CEDEAO-UEMOA. Les montants affectés ne le sont que lors de requêtes ponctuelles, ce qui pourrait conduire à un éparpillement des ressources pour le financement des divers projets régionaux la distinction faite entre l’Afrique Occidentale côtière et sahelienne n’est pas toujours pertinente en raison de la diversité des projets.
De fait les observations relatives à l’ensemble des programmes régionaux s’appliquent parfaitement aux PIR de l’Afrique de l’Ouest [Amos Tincani: La coopération régionale sous Lomé: expérience et évolution des trois conventions. Le courrier ACP. Le n ° 112 P. 73.], à savoir:
[page-number of print-ed.(French part): 13]
- La nécessité d’accorder une plus grande attention à la programmation régionale au lieu de la reléguer à l’annexe III des programmes indicatifs nationaux.
- L’instauration d’un dialogue multilatéral plus poussé entre les états de la région et leurs principales organisations régionales permettant de bien établir les priorités et d’envisager les cofinancements possibles pour l’intégration régionale.
- L’étude attentive de la question de l’existence et du poids des acteurs et des projets pouvant impulser et participer au processus d’intégration en Afrique de l’Ouest.
3.2 L’ajustement structurel
Comme on l’a déjà indiqué, l’un des objectifs centraux de la Convention de Lomé est le renforcement de la coopération régionale et la création progressive d’espaces économiques intégrés. Or l’UE, notamment dans le cadre de Lomé IV, fait de l’ajustement structurel l’un des instruments de la politique de développment dans les pays ACP. Ainsi se pose le problème des relations entre les programmes d’ajustement structurel et les perspectives d’intégration régionale, notamment en Afrique de l’Ouest.
Or selon J. Coussy et Ph. Hugon (1991), „le processus d’ajustement joue un rôle, positif et négatif, sur les coopérations et les intégrations régionales. Les PAS visent notamment à assainir les finances publiques, à ouvrir et à libéraliser les économies. Mais conçus dans un cadre national, à des dates différentes et selon des séquences diverses, ils rendent incertaine la convergence des politiques économiques nationales. Leurs effets observés diffèrent des attentes. La non prise en compte des interdépendances entre les structures et entre les politiques économiques peut ainsi menacer les intégrations en cours". [In „Intégration régionale et ajustement structurel en Afrique Sub-Saharienne" op cit P. 11.]
De fait les résultats de ces ajustements ont été jugés décevants. Il sont restés bien en deçà de ce qui était espéré, dans les pays ACP. [Selon P. et S. Guillaumont: Ajustement et Développement: l’experience des pays ACP. Economica Paris 1994.]
Or en principe, l’ajustement serait un atout pour l’intégration régionale dans la mesure où l’assainissement des économies nationales devrait créer des conditions plus favorables pour développer une véritable coopération régionale et construire à terme des espaces intégrés. En réalité, l’ajustement structurel a une logique nationale, aussi bien dans ses objectifs que dans ses instruments. [CF J; cl. Boidin: la coopération régionale à l’éprueve de l’ajustement structurel. Le courrier ACP-CE n ° 112 Nov. Dec. 1988.]
Le problème reste donc de savoir si l’objectif de Lomé IV, qui est d’adopter un programme d’ajustement structurel adapté aux conditions spécifiques des pays ACP, peut être atteint dans la mesure où la logique des PAS qui reste par essence nationale, libérale et orientée vers le court terme, peut se concilier avec des stratégies d’intégration économique qui relèvent d’une approche régionale volontariste et à long terme.
Ainsi, pour l’Afrique de l’Ouest, les efforts certes timides tentés par l’UE pour l’intégration régionale sont limités par les PAS soit des organismes de Bretton Woods, soit de l’UE elle-même à travers Lomé IV notamment.
3.3 Le secteur privé et autres acteurs
Les relations entre l’UE et l’Afrique de l’Ouest se déterminent principalement dans le cadre des politiques définies par les états membres de l’UE et au niveau de la Commission Européenne. Cependant, d’autres acteurs sont en jeu notamment au niveau du secteur privé. C’est ainsi que les compagnies de commerce, les sociétés minières, les grandes unités agro-industrielles ou des grandes industries de l’UE jouent un rôle dans ces relations.
Dans le cadre de l’Afrique de l’Ouest, les stratégies régionales ont été adoptés au niveau des grandes sociétés de commerce comme Bolloré,
[page-number of print-ed.(French part): 14]
CFAO, SCOA. Ces sociétés s’établissent dans divers états de l’Afrique de l’Ouest et contribuent à l’intégration régionale de ces états. De même, divers groupes industriels ont adopté des stratégies similaires.
Certes ces sociétés cherchent à réduire les coûts de transaction, à pallier les défaillances du marché et à réduire les incertitudes de l’environnement. Elles cherchent également à bénéficier des distorsions de politiques économiques en jouant sur les concurrences ou sur les complémentarités nationales. Cependant elles contribuent ainsi au renforcement du processus d’intégration. Il en est de même des réseaux d’entrepreneurs et des organisations professionnelles.
Outre le secteur privé, d’autres initiatives peuvent être relevées dans le cadre des relations entre l’UE et l’Afrique de l’Ouest. C’est le cas notamment des relations dans le cadre de la coopération decentralisée, entre communes de l’UE et de l’Afrique de l’Ouest ou entre universités et centres de recherche. C’est ainsi qu’avec le programme SADAOC (Sécurité Alimentaire Durable en Afrique de l’Ouest Centrale), des universités des Pays-Bas coopèrent avec celles du Burkina, de Côte d’Ivoire, du Ghana, du Mali et du Togo.
[page-number of print-ed.(French part): 15]
4. Vers de nouvelles relations Afrique de l’ouest-UE
Les nouvelle relations entre l’Afrique de l’Ouest et l’UE, pour être pertinentes et durables, doivent reposer aussi bien sur des motivations explicites et surtout sur des intérêts communs que sur la définition de nouvelles priorités dans le cadre de nouvelles institutions de coopération.
A/ Les intérêts communs
La géographie et l’histoire ont tissé des liens tellement étroits entre l’Afrique de l’Ouest et l’UE que ces régions ont besoin l’une de l’autre. Malgré une évolution mondiale qui va dans le sens d’une distanciation de ces relations traditionnelles, les intérêts communs actuels et potentiels demeurent d’importance et l’on se contentera dans ce document de quelques aspects généraux pour susciter le débat. Ces intérêts communs sont principalement de quatre ordres:
D’abord l’aspect géopolitique qui s’exprime par la recherche de la sécurité par l’Europe et de la stabilité pour l’Afrique. Or depuis la chute du communisme, l’une des menaces que l’on semble redouter dans l’UE c’est quelque intégrisme religieux, et une stratégie de contournement de ce danger passerait par l’Afrique Occidentale.
Du côté africain il est évident que des relations confiantes avec l’Europe peuvent contribuer à stabiliser les pays africains et à les rendre plus efficaces, de même ces relations confiantes permettraient en Afrique un approfondissement de la démocratie.
Quant aux intérêts économiques réciproques, ils sont évidents: en effet même si les progrès technologiques tendent à une réduction de la demande de matières premières, l’UE a encore besoin de produits provenant de l’Afrique de l’Ouest pour la satisfaction de ses besoins: bauxite, pétrole, café, cacao…
De son côté l’Afrique de l’Ouest, outre les biens d’équipement, doit bénéficier de la part de l’Europe d’un marché d’exportation et des aides alimentaires ainsi que des moyens nécessaires pour la lutte à conduire contre la pauvreté et la faim, qui ont un effet de déstabilisation sur la région.
Sur le plan social, les intérêts communs peuvent être soulignés sur deux plans principaux:
D’une part la situation démographique en Afrique de l’Ouest est bien connue: elle se traduit par une explosion qui alimente des flux migratoires internes et externes, flux que l’Europe tente de contenir, notamment l’émigration sauvage.
D’autre part, les problèmes de santé sont aigus, notamment la lutte contre les épidémies diverses, surtout la pandemie du SIDA.
Enfin, du point de vue de l’environnement, les interêts communs ont été mis en lumière dans le cadre de la conférence de Rio et l’adoption des programmes de défense de l’environnement dans le cadre du „village planétaire".
Dans tous ces domaines d’intérêt commun, le problème qui se pose est celui de l’équilibre et la nécessité de rendre visible l’interaction entre les deux groupes de pays. En outre, dans des pays comme ceux de l’Afrique de l’Ouest où l’organisation de type traditionnel est toujours présente, le lien entre tradition et modernité est fondamental et implique une gestion décentralisée.
B/ La future coopération
L’importance et la diversité des forces de changement dans les relations entre l’UE et les pays ACP sont évidentes; il s’agit notamment de la mondialisation de l’économie, de l’approfondissement de l’UE et de son élargissement, de la
[page-number of print-ed.(French part): 16]
création de l’organisation mondiale du commerce (OMC) ou des innovations technologiques.
Tous ces changements entraînent l’apparition d’un contexte mondial nouveau qui rend nécessaire une réflexion prospective autonome au niveau de chacune des régions ACP. L’objet de la coopération est bien de rendre les pays ACP plus autonomes en les engageant sur la voie d’un développement endogène. Or cette indépendance réelle ne peut être effective que dans le cadre régional, il est donc nécessaire que la coopération rénovée adopte l’optique d’une stratégie régionale.
Au niveau de l’Afrique de l’Ouest cette stratégie régionale devra mettre l’accent sur quelques secteurs stratégiques et le problème institutionnel. Il nous faut ainsi évoquer:
- L’Afrique de l’Ouest et les Futurs de la Convention de Lomé;
- Les secteurs stratégiques à couvrir;
- Les institutions de la future coopération.
4.1 L’Afrique de l’Ouest et les Futurs de la Convention de Lomé
La conférence de Maastricht qui, en Juillet 1990, a créé la coalition Mondiale pour l’Afrique (CMA) avait abouti à un consensus tendant à confier à l’UE un rôle majeur dans le renforcement de l’intégration régionale en Afrique et à situer la démarche pour l’analyse des problèmes africains dans le cadre d’études prospectives à long terme.
C’est dans ce contexte que l’on se propose au Centre Ivoirien de Recherche Economique et Sociale (CIRES) de réfléchir, dans le cadre d’un atelier sur l’Afrique de l’Ouest et les futurs de la Convention de Lomé. Il s’agit de définir la problématique de ces évolutions:
- D’une part en identifiant les aspirations des populations de la région, ce à quoi elles aspirent dans leurs relations avec les pays de l’UE.
- D’autre part en formulant un diagnostic stratégique de ces relations; ce diagnostic devant concerner l’intégration et le développement régional dans ses relations avec l’UE.
A cet effet l’on procédera à la construction de trois ou quatre scénarios contrastés de l’évolution de ces relations dans le cadre de l’intégration en Afrique de l’Ouest. Ensuite, il faudra déduire de ces scénarios les principaux thèmes de recherche qui permettent de donner une réponse pertinente aux principaux aspects de l’Après-Lomé IV en Afrique de l’Ouest.
Cette démarche tient à la nécessité d’un nouvel engagement politique dont la base dépend, c’est évident, de notre vision du futur.
La priorité ainsi accordée à l’intégration régionale dans la vision du futur permet également d’accroître l’efficacité de l’aide de l’UE en atténuant le problème de sa fongibilité c’est-à-dire d’éviter que l’aide entraîne un accroissement des dépenses en biens de consommation, comme l’affirme la théorie de la fongibilité de l’aide.
4.2 Les secteurs stratégiques de coopération
Dans le cadre d’une coopération rénovée entre les pays ACP et l’UE certains secteurs d’activité apparaissent stratégiques pour l’intégration économique en Afrique de l’Ouest aussi bien pour la CEDEAO que pour l’UEMOA.
Il s’agit principalement des secteurs suivants, pour lesquels des contrats périodiques de projets à objectifs précis devraient être conclus, avec des critères de performance.
a) Les infrastructures d’intégration
Il s’agit du développement des transports (routiers, ferroviaires, aériens et maritimes), des télécommunications et de l’énergie en vue d’une intégration effective des pays de l’Afrique de l’Ouest.
b) Les ressources humaines et la recherche
La nécessité d’une recherche autonome dans les pays africains est bien connue, de même que les difficultés d’atteindre le seuil critique d’efficacité de cette recherche dans chaque pays: l’appui de l’UE est donc nécessaire pour développer cette
[page-number of print-ed.(French part): 17]
activité à l’échelon régional en favorisant d’une part la constitution de pôles régionaux de formation et de recherche, d’autre part l’accès aux réseaux de l’information.
De même, le renforcement des capacités des ressources humaines est nécessaire („capacity building", formation, santé).
c) La promotion du secteur privé
L’UE est sollicitée dans divers pays ACP pour faciliter le processus de privatisation de certaines entreprises. Mais apparaît la nécessité de promouvoir le secteur privé comme facteur d’intégration régionale et de l’accroissement de la compétitivité de l’économie régionale.
C’est dans ce contexte régional qu’un partenariat efficace entre secteurs privés européen et africain pourra mieux se développer, aussi bien pour le partenariat industriel que pour les stratégies commerciales.
d) Le financement du développement et la dette extérieure
Dans le cadre de la coopération rénovée entre l’UE et les ACP, il sera nécessaire de réfléchir au problème des moyens permettant de mieux drainer les investissements étrangers dans les pays ACP. La conversion des dettes publiques en actifs d’entreprises à privatiser pourrait être l’un de ces moyens.
Pourrait-on envisager dans ce contexte la création d’un Fonds Monétaire et d’une Banque de Développement euro-africains comme le proposent certains auteurs? [CF, Le groupe Nobil, in „Pour une nouvelle alliance Afrique-Europe" Futuribles Paris 1992.] Il s’agirait de transformer des créances sur l’Afrique en une dette perpétuelle de l’Afrique envers ce fonds et la banque grâce au paiement de la moitié des contributions des pays de l’UE sous forme de créances décotées après renoncement aux intérêts.
Cette proposition, bien que pertinente, supposerait une très forte motivation de l’UE pour une nouvelle coopération avec les pays africains. Pour le moment, l’accès à des financemnts adaptés, notamment grâce à une large ouverture de l’accès aux crédits de la BEI, serait très utile de même qu’un appui à la convertibilité des monnaies, à la stabilité et la coopération monétaires en Afrique de l’Ouest. De même l’appui au développement de marchés financiers.
e) L’environnement: le Sahel, les forêts et lagunes
L’appui de l’UE dans ce domaine devra être mieux défini qu’il s’agisse de la lutte contre la désertification dans le cadre du CILSS ou de celle contre la déforestation, de la pollution des lagunes ou de l’érosion des côtes maritimes.
f) Gouvernance et Démocratie
Dans le cadre de l’intégration régionale, la stabilité des régimes politiques des états membres de la CEDEAO pourrait être mieux assurée grâce d’une part à la reduction sinon à l’élimination des conflits frontaliers, d’autre part à la coopération en vue de resoudre les conflits internes.
Par ailleurs la coopération régionale dans le cadre d’institutions supra-nationales tend à réduire le caractère quelque peu patrimonial des divers états de la région soit donc des mesures tendant à les déprivatiser, ce qui en retour, concourt à la recherche de nouveaux paradigmes d’intégration en Afrique de l’Ouest et à l’approfondissement de la démocratie participative dans la région.
De même l’UE pourrait contribuer à l’éveil des forces sociales pour promouvoir la volonté politique d’intégration régionale grâce à une campagne populaire soutenue par les intellectuels, les médias, les syndicats, les fédérations professionnelles etc.
[page-number of print-ed.(French part): 18]
5. Conclusion:
Les institutions de la coopération rénovée
Les résultas de la réflexion sur les domaines de la coopération rénovée permettront de mieux concevoir les institutions de cette coopération. Cependant, il est à noter que les problèmes deviennent de plus en plus complexes et spécifiques dans chacune des régions du groupe ACP et que la diversité entre les groupes s’accentue. Cependant la nécessité d’une unité d’action s’impose en vue de se constituer comme puissance de négociation.
Une coopération vraiment rénovée suppose un dialogue politique à un haut niveau aussi bien dans le cadre ACP-UE qu’à celui des différentes régions pour des questions particulières à ces régions.
Le caractère durable et l’efficacité de cette coopération rénovée seront fonction du respect mutuel, mais aussi de l’intensité de ce dialogue au profit des intérêts réciproques.
(Quelques données économique 1994)
Pays |
Population (milliers) |
PIB (prix du marché) |
Exportation (biens et services) |
Importations (biens et services) |
Dette extérieure |
Service de la dette |
ADP |
1. Bénin |
5246 |
1289 |
367 |
378 |
1555 |
71 |
289 |
2. Burkina Faso |
10046 |
1967 |
291 |
498 |
1304 |
56 |
470 |
3. Cap-Vert |
381 |
225 |
47 |
166 |
178 |
14 |
115 |
4. Cote-d’Ivoire |
13780 |
6811 |
3555 |
1705 |
20156 |
549 |
766 |
5. Gambie |
1081 |
279 |
75 |
104 |
415 |
27 |
90 |
6. Ghana |
16944 |
6792 |
1427 |
2470 |
4817 |
196 |
621 |
7. Guinée |
6501 |
3805 |
1145 |
894 |
3097 |
115 |
413 |
8. Guinée-Bissau |
1050 |
353 |
78 |
164 |
822 |
3 |
98 |
9. Liberia |
2941 |
1019 |
527 |
206 |
1936 |
20 |
126 |
10. Mali |
10462 |
1630 |
345 |
515 |
2820 |
24 |
374 |
11. Mauritanie |
2217 |
882 |
348 |
496 |
2295 |
97 |
338 |
12. Niger |
8846 |
1703 |
367 |
268 |
1801 |
35 |
347 |
13. Nigeria |
108467 |
117304 |
12493 |
5097 |
33436 |
1979 |
280 |
14. Sénégal |
8102 |
3091 |
1053 |
1148 |
3885 |
280 |
497 |
15. Sierra Leone |
4402 |
1102 |
148 |
195 |
1508 |
26 |
204 |
16. Togo |
4010 |
836 |
374 |
448 |
1303 |
78 |
100 |
Total |
204.476 |
149.088 |
22.640 |
14.752 |
81.328 |
3.570 |
5.128 |
Source: Calculs selon les statistiques de BAD: „Rapport sur le Développement en Afrique 1995".
[page-number of print-ed.(French part): 19]
Au sujet de l’auteur
Le Professeur Charles Valy Tuho est actuellement chercheur au Centre de Recherche Economique et Sociale (CIRES) à Abidjan en Côte d’Ivoire. De 1983 à 1993 il a été l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire auprès des pays du Bénélux et de la Communauté Européenne. Il a aussi eu une carrière remarquable comme Professeur de Sciences Economiques (1970-1972) à l’Université d’Abidjan, comme doyen de la Faculté des Sciences Economiques (1972-1974) et comme Recteur de l’Université d’Abidjan (1974-1983). Le Professeur Tuho est membre du Conseil de l’Université Volante Internationale (U.V.I.) à Genève. De 1986 à 1992 il a été membre du Conseil de l’Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI) à Washington. Il a aussi été membre du Conseil de l’Université des Nations-Unies à Tokyo (1980-1985). Il a obtenu en 1970 l’Agrégation de Sciences Economiques à Paris. Il a soutenu en 1965 sa thèse de doctorat de Sciences Economiques à Paris après y avoir obtenu en 1962 un D.E.S. de Sciences Economiques.
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Februar 2002